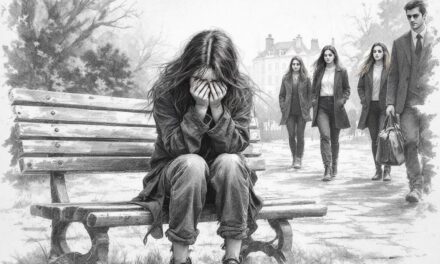Un soldat français et un soldat britannique marchent côte à côte dans une rue de Londres en 1914. Ils ont le même uniforme, les mêmes bottes, la même fatigue. Pourtant, quelque chose cloche. Leurs démarches ne s’accordent pas. Le Français balance les bras de façon ample, le Britannique garde les coudes serrés. Leurs pas ne trouvent jamais le même rythme. L’un semble glisser, l’autre marteler le sol.
Cette observation apparemment anodine va révolutionner l’anthropologie. Marcel Mauss, observant ce décalage durant la Première Guerre mondiale, comprend que même les gestes les plus « naturels » sont en réalité des constructions culturelles. Marcher, s’asseoir, dormir, nager : rien de tout cela n’est universel. Chaque société fabrique ses propres façons d’utiliser le corps. En 1936, il publie un texte fondateur : Les techniques du corps. Ce court article pose les bases d’une anthropologie du geste qui irrigue encore la recherche contemporaine et enrichit notre compréhension de ce qu’est la sociologie. Mais que sont exactement ces techniques ? Et pourquoi bouleversent-elles notre compréhension de ce que signifie être humain ?
Table des matières
Ce que Mauss appelle « technique du corps » : définir l’évidence invisible
Marcel Mauss définit les techniques du corps comme « les façons dont les hommes, société par société, d’une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps ». Cette définition, d’apparence simple, contient une révolution conceptuelle. Elle affirme que le corps humain, loin d’être un donné biologique universel, est façonné par la culture.
Pour Mauss, une technique du corps possède trois caractéristiques. Elle est efficace : elle permet d’atteindre un but pratique (se déplacer, se nourrir, se reposer). Elle est traditionnelle : elle se transmet de génération en génération au sein d’un groupe social. Elle est apprise : personne ne naît en sachant marcher à la française ou à l’anglaise, on l’apprend par imitation.
💡 DÉFINITION : Technique du corps
Une technique du corps est un acte traditionnel efficace, acquis par apprentissage social, qui mobilise le corps pour atteindre un but pratique. Elle combine dimensions physique, psychologique et sociale, et varie d’une culture à l’autre.
Exemple : La façon de nager varie culturellement. Les Européens apprennent majoritairement la brasse ou le crawl (tête hors de l’eau ou immergée). Les populations côtières du Pacifique développent des techniques de nage adaptées aux vagues et courants, privilégiant la position verticale et l’économie d’énergie.
Mauss classe ces techniques selon plusieurs critères. Par âge d’abord : les techniques de l’enfance (ramper, marcher), de l’adolescence (danser, courir), de l’âge adulte (porter des charges) et de la vieillesse (se mouvoir avec difficulté) diffèrent. Par sexe ensuite : chaque société attribue certains gestes aux hommes, d’autres aux femmes. Par rendement enfin : certaines techniques privilégient l’efficacité, d’autres le style ou la conformité sociale.
L’intuition centrale de Mauss tient en une phrase : « Il n’y a pas de technique et pas de transmission, s’il n’y a pas de tradition ». Autrement dit, nos gestes quotidiens ne relèvent pas de l’instinct biologique mais de l’apprentissage culturel. Un enfant laissé seul ne développerait pas spontanément la démarche, la posture ou les gestes de son groupe social. Il faut l’intervention d’autrui, la transmission d’un savoir-faire corporel collectif.
Cette idée brise la frontière entre nature et culture. Le corps n’est pas un donné préalable à la culture, il est le premier lieu de son inscription. Avant d’apprendre une langue ou des normes morales, l’enfant apprend à utiliser son corps d’une certaine façon. Et cette façon porte déjà la marque de sa société d’appartenance, ce que Bourdieu développera plus tard dans sa théorie de l’habitus.
La diversité culturelle des gestes quotidiens : marcher, dormir, accoucher
Mauss illustre sa théorie par une multitude d’exemples tirés de ses observations et de la littérature ethnographique. La marche constitue son cas d’école. Il note que les infirmières américaines marchaient différemment des infirmières françaises durant la guerre. Les Américaines avançaient avec de grandes enjambées, les Françaises avec des pas plus courts et rapides. Ces différences ne s’expliquent ni par l’anatomie ni par le climat, mais par l’éducation corporelle reçue dès l’enfance.
Plus frappant encore : Mauss observe que dans certaines sociétés, on marche pieds en dedans (Maoris de Nouvelle-Zélande), dans d’autres pieds en dehors (danseurs de ballet classique occidental), dans d’autres encore pieds parallèles(norme européenne contemporaine). Chacune de ces démarches résulte d’un apprentissage spécifique, validé socialement, transmis par imitation.
Le sommeil offre un autre exemple saisissant. Mauss constate que les sociétés diffèrent radicalement dans leurs techniques de repos. En Europe, la norme est le sommeil allongé, sur un matelas, dans une pièce fermée. Mais de nombreuses sociétés dorment accroupies (certaines populations d’Afrique de l’Ouest), assises (populations andines), ou suspendues dans des hamacs (Amazonie). Ces positions, inconfortables pour qui n’y est pas habitué, procurent un repos parfait à ceux qui les ont incorporées depuis l’enfance.
📊 CHIFFRE-CLÉ
68% des sociétés traditionnelles recensées par les ethnologues pratiquent l’accouchement en position verticale ou accroupie, contre seulement 12% en position allongée. La position gynécologique occidentale (allongée sur le dos) est minoritaire mondialement et relativement récente (généralisée au XIXe siècle pour faciliter les interventions médicales).
Source : Base de données ethnographiques eHRAF, Yale University, 2019
L’accouchement révèle particulièrement la construction culturelle des techniques corporelles. En Occident, la position allongée sur le dos domine depuis le XIXe siècle. Mais cette technique n’a rien de « naturel ». Elle répond aux besoins de la médicalisation (faciliter l’intervention du médecin), pas à ceux de la parturiente. Dans la majorité des sociétés traditionnelles, les femmes accouchent debout, accroupies ou à genoux, positions qui utilisent la gravité et facilitent le travail musculaire.
Ces exemples montrent que même les actes les plus intimes, ceux que nous croyons dictés par notre biologie, sont en réalité façonnés par la culture. Le corps possède des potentialités multiples, que chaque société actualise différemment selon ses normes, ses environnements et ses savoirs. Ce phénomène s’observe également dans la métamorphose numérique des identités de genre, où les techniques corporelles se réinventent à travers les écrans.

Transmission et apprentissage : comment le geste devient tradition
Mauss insiste sur le processus de transmission des techniques du corps. Celle-ci s’opère rarement par enseignement explicite. Personne ne donne de « cours de marche » ou de « leçons de posture ». L’apprentissage se fait par imitation : l’enfant observe les adultes et reproduit spontanément leurs gestes.
Cette imitation n’est pas passive. Elle mobilise ce que Mauss appelle l’éducation de la confiance : l’enfant fait confiance aux adultes et cherche à reproduire leurs actes, même quand il ne comprend pas leur finalité. Un bébé voit sa mère marcher et tente de l’imiter, bien avant de comprendre pourquoi ni comment marcher. Cette confiance constitue le moteur premier de la transmission culturelle.
Mauss distingue deux modalités d’apprentissage. L’imitation prestigieuse d’abord : l’enfant imite les personnes qu’il admire ou qui ont de l’autorité sur lui (parents, aînés, figures respectées). La contrainte sociale ensuite : le groupe corrige, encourage ou sanctionne certains gestes, renforçant l’apprentissage. Un enfant qui s’assoit « mal » sera repris, un autre qui maîtrise un geste valorisé sera félicité.
Cette transmission produit ce que Mauss nomme l’habitude corporelle : une disposition durable à accomplir certains gestes de façon automatique. Une fois incorporée, la technique devient inconsciente. On ne réfléchit plus à comment marcher, s’asseoir ou porter un objet. Le corps « sait » directement.
Les danses traditionnelles illustrent parfaitement ce processus. Dans de nombreuses sociétés, les danses collectives constituent des moments privilégiés de transmission corporelle. Les enfants participent dès le plus jeune âge, imitant les mouvements des adultes. Progressivement, leur corps intègre les rythmes, les postures, les enchaînements spécifiques à leur culture. Un danseur balinais, un danseur maori et un danseur andalou possèdent des techniques corporelles radicalement différentes, acquises par des années de pratique collective.
Mauss anticipe ici les travaux ultérieurs sur la mémoire corporelle et l’apprentissage kinesthésique. Le corps possède sa propre forme de mémoire, distincte de la mémoire cognitive. Cette mémoire gestuelle se constitue par répétition et s’active automatiquement dans les contextes appropriés. Elle explique pourquoi un geste appris dans l’enfance persiste toute la vie, même après des décennies sans pratique.
Implications et débats : technique, efficacité et relativisme culturel
La théorie des techniques du corps soulève des questions importantes. Si chaque société développe ses propres façons d’utiliser le corps, peut-on comparer leur efficacité ? Certaines techniques sont-elles objectivement supérieures à d’autres ?
Mauss adopte une position nuancée. Il reconnaît que certaines techniques offrent des avantages mécaniques mesurables. La position accroupie pour accoucher facilite effectivement le travail musculaire et utilise la gravité. Les techniques de nage des populations océaniennes sont objectivement plus économes en énergie dans les conditions de haute mer. Mais il refuse tout évolutionnisme : les techniques occidentales ne sont pas le sommet d’une progression universelle.
Chaque technique doit être évaluée dans son contexte environnemental et social. Une démarche efficace sur terrain plat devient inadaptée en forêt dense ou en montagne. Une posture confortable pour un travail sédentaire devient pénible pour un travail physique. Il n’existe pas de technique universellement optimale, seulement des techniques adaptées à des milieux et des activités spécifiques.
Cette approche conduit Mauss à critiquer l’impérialisme corporel occidental. La colonisation n’a pas seulement imposé des langues, des religions ou des systèmes politiques. Elle a aussi imposé des techniques du corps : façons de s’asseoir (chaises), de dormir (lits), de marcher (chaussures), de se laver (douches). Or ces techniques, adaptées aux environnements européens, se révèlent souvent inadaptées aux environnements tropicaux ou aux modes de vie nomades.
Les débats contemporains prolongent ces réflexions. Les recherches en biomécanique confirment que différentes techniques corporelles sollicitent différemment les muscles et les articulations. La position accroupie prolongée, impossible pour la majorité des Occidentaux adultes, préserve la flexibilité articulaire et prévient certaines pathologies du dos. La marche pieds nus développe une proprioception supérieure et renforce la musculature plantaire.
Ces découvertes scientifiques valident l’intuition de Mauss : la diversité des techniques corporelles n’est pas un vestige archaïque à dépasser, mais un répertoire de solutions adaptatives que les sociétés industrielles ont parfois perdu à leurs dépens. La standardisation des corps par l’ergonomie occidentale produit ses propres pathologies : maux de dos chroniques, troubles musculo-squelettiques, perte de mobilité articulaire.
Qu’est-ce que cela change pour nous ? Comprendre les techniques du corps comme constructions culturelles nous libère d’une vision biologisante de l’humanité. Nos gestes quotidiens ne sont pas dictés par notre anatomie, mais par notre histoire sociale. Cette prise de conscience ouvre la possibilité de réapprendre, de transformer nos habitudes corporelles, de réintégrer des techniques perdues ou d’en inventer de nouvelles. Elle nous rappelle aussi que chaque façon d’utiliser son corps mérite respect : il n’y a pas de gestes « primitifs » ou « civilisés », seulement des techniques différentes, adaptées à des contextes différents.

Conclusion
Les techniques du corps de Marcel Mauss révèlent que rien n’est naturel dans nos gestes quotidiens. Marcher, s’asseoir, dormir, accoucher : tout est appris, transmis, façonné par la culture. Cette découverte, formulée en 1936, demeure d’une actualité troublante. À l’heure où la mondialisation standardise les corps, où l’ergonomie occidentale s’impose comme norme universelle, les travaux de Mauss nous rappellent la richesse de la diversité gestuelle humaine.
Chaque société a développé ses propres façons d’habiter le corps, adaptées à son environnement, à ses activités, à ses valeurs. Cette diversité constitue un patrimoine aussi précieux que la diversité linguistique ou culturelle. Sa disparition nous appauvrit collectivement, nous privant de solutions corporelles éprouvées par des millénaires de pratique. Ce phénomène s’observe particulièrement chez les peuples forestiers contraints à l’urbanisation, qui voient leurs techniques corporelles ancestrales s’effacer en quelques générations.
Et vous, avez-vous observé des façons différentes d’utiliser le corps lors de voyages ou de rencontres interculturelles ? Partagez votre expérience ou découvrez notre analyse sur la mémoire corporelle des peuples forestiers en milieu urbain.
FAQ
Qu’est-ce qu’une technique du corps selon Mauss ?
Une technique du corps est une façon traditionnelle et efficace d’utiliser son corps, transmise par apprentissage social au sein d’un groupe culturel. Contrairement aux réflexes biologiques innés, les techniques du corps sont acquises par imitation et éducation. Elles incluent tous les gestes quotidiens : marcher, s’asseoir, dormir, manger, porter, nager. Mauss montre que ces gestes varient considérablement d’une société à l’autre.
Comment les techniques du corps se transmettent-elles ?
Les techniques du corps se transmettent principalement par imitation inconsciente durant l’enfance. L’enfant observe les adultes de son groupe et reproduit spontanément leurs gestes, sans enseignement explicite. Cette transmission opère par ce que Mauss appelle « l’imitation prestigieuse » (copier les figures d’autorité) et par contrainte sociale douce (corrections, encouragements). La répétition quotidienne transforme ces gestes appris en habitudes corporelles automatiques.
Pourquoi les soldats français et britanniques marchaient-ils différemment ?
Les soldats français et britanniques marchaient différemment parce qu’ils avaient incorporé des techniques de marche distinctes durant leur enfance respective. Les Français balançaient davantage les bras, les Britanniques gardaient les coudes plus serrés. Ces différences résultent d’éducations corporelles nationales spécifiques, transmises inconsciemment par les familles et les institutions. Mauss utilise cet exemple pour montrer que même la marche, geste apparemment universel, est culturellement construite.
Les techniques du corps occidentales sont-elles supérieures aux autres ?
Non. Mauss rejette tout évolutionnisme qui placerait les techniques occidentales au sommet d’une hiérarchie. Chaque technique doit être évaluée dans son contexte environnemental et social. La position accroupie pour accoucher, par exemple, offre des avantages biomécaniques par rapport à la position allongée occidentale. La standardisation mondiale des techniques occidentales appauvrit le répertoire gestuel humain et impose des normes parfois inadaptées à d’autres environnements.
Bibliographie
Ingold, Tim. 2000. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London : Routledge.
Mauss, Marcel. 1936. Les techniques du corps (article dans Journal de Psychologie). Paris : PUF (réédition 1950 dans Sociologie et Anthropologie).
Mauss, Marcel. 1950. Sociologie et Anthropologie. Paris : PUF.
Le Breton, David. 1990. Anthropologie du corps et modernité. Paris : PUF.
Vigarello, Georges. 2004. Histoire du corps (3 volumes). Paris : Seuil.
Héritier, Françoise. 1996. Masculin/Féminin. La pensée de la différence. Paris : Odile Jacob.
Yale University. 2019. eHRAF World Cultures Database : Cross-Cultural Study of Birth Practices. New Haven : Yale Publications.