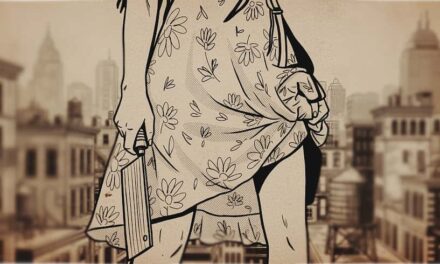Salaire à six chiffres, appartement cossu, vacances aux Maldives. Pourtant, Léa, 34 ans, cadre dans une multinationale, avoue ronger son frein chaque fois qu’une collègue décroche une promotion. « Sur le papier, j’ai tout. Mais quand je vois qu’elle a été choisie pour le comité de direction, j’ai l’impression d’avoir échoué. » Son témoignage n’a rien d’exceptionnel.
Pourquoi la jalousie frappe-t-elle même ceux qui semblent avoir tout pour être heureux ? Deux théories sociologiques éclairent ce paradoxe : la théorie de la privation relative et la théorie du contrôle social. Ensemble, elles révèlent comment nos émotions se construisent moins sur ce que nous possédons que sur ce que nous voyons chez les autres.
Table des matières
La privation relative : Quand tout avoir ne suffit jamais
En 1949, le sociologue américain Samuel Stouffer étudie le moral des soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Surprise : les aviateurs, mieux payés et promus plus rapidement, se disent moins satisfaits que les fantassins. L’explication ? Ils se comparent à leurs pairs, pas à l’ensemble de l’armée.
Cette découverte fonde la théorie de la privation relative : notre satisfaction dépend moins de notre situation objective que du fossé perçu entre ce que nous avons et ce qu’ont nos groupes de référence. Autrement dit, gagner 80 000 euros par an peut sembler dérisoire si votre meilleur ami en gagne 120 000.
💡 DÉFINITION : Privation relative
Sentiment de frustration ressenti lorsqu’un individu estime que sa situation est désavantageuse par rapport à celle d’autrui ou par rapport à ses propres attentes. Cette perception subjective existe indépendamment de la situation objective.
Exemple : Un cadre gagnant bien sa vie peut se sentir « pauvre » s’il fréquente des entrepreneurs millionnaires.
Les deux visages de la privation
On distingue deux formes de privation relative :
- Égocentrique : Je compare ma situation à celle d’autres individus. « Pourquoi elle a obtenu cette augmentation et pas moi ? »
- Fraternelle : Mon groupe se compare à d’autres groupes. « Notre département reçoit moins de budget que le leur. »
La première alimente la jalousie interpersonnelle. La seconde peut mener à des mouvements sociaux.
Le piège des attentes croissantes
Plus nous possédons, plus nos aspirations augmentent. Ce phénomène, identifié par le psychologue Leon Festinger dans sa théorie de la comparaison sociale, crée un écart permanent entre réalité et désirs.
Un diplômé de grande école visera un poste de direction à 30 ans. S’il ne l’obtient qu’à 35, il se sentira en retard, même si objectivement sa trajectoire reste exceptionnelle. La jalousie naît de cet écart entre ce que nous estimons mériter et ce que nous obtenons.
Le contrôle social : La jalousie comme régulateur invisible
En 1969, le criminologue Travis Hirschi publie Causes of Delinquency. Il y défend une thèse provocante : ce n’est pas la déviance qui pose question, c’est la conformité. Pourquoi la plupart des gens respectent-ils les normes ?
Sa réponse tient en quatre piliers du contrôle social :
- L’attachement : Nos liens affectifs avec les autres nous retiennent.
- L’engagement : L’investissement dans une carrière, une réputation nous discipline.
- L’implication : La participation à des activités valorisées nous ancre.
- La croyance : L’adhésion aux valeurs dominantes nous guide.
Ces mécanismes, initialement pensés pour expliquer la criminalité, s’appliquent remarquablement à la jalousie.
Quand la jalousie surveille nos comportements
La jalousie fonctionne comme un rappel à l’ordre social invisible. Elle surgit quand quelqu’un menace notre position dans la hiérarchie des attachements, des engagements ou des croyances.
Prenons l’attachement. La jalousie amoureuse explose précisément parce qu’un lien vital semble menacé. Même chose en amitié : voir sa meilleure amie se rapprocher d’une autre déclenche une alerte émotionnelle.
L’engagement professionnel fonctionne pareil. Un collègue qui réussit mieux nous rappelle que nos investissements (heures supplémentaires, formations) ne garantissent rien. Cette anxiété nourrit la jalousie, même si nous sommes objectivement bien lotis.
La croyance aux idéaux inatteignables
Nos sociétés valorisent le succès, la beauté, la performance. Ces croyances deviennent des standards impossibles à satisfaire. Une actrice célèbre enviera une consœur plus jeune. Un entrepreneur prospère jalousera un concurrent plus médiatisé.
La jalousie devient alors le prix à payer pour croire en des idéaux qui, par définition, maintiennent toujours une partie de la population en situation de privation relative.
Instagram et LinkedIn : Amplificateurs de jalousie moderne
Les réseaux sociaux fonctionnent comme des machines à privation relative. Ils multiplient les occasions de comparaison tout en ne montrant que les aspects valorisés de la vie d’autrui.
La vitrine permanente du succès
Sur LinkedIn, chacun annonce ses promotions, ses distinctions, ses conférences. Sur Instagram, vacances idylliques et silhouettes sculptées défilent. Cette sélection biaisée crée une norme de succès hors-sol.
Une étude menée en 2022 auprès de 1 500 jeunes actifs européens révèle que 68 % ressentent régulièrement de la jalousie en consultant les réseaux professionnels, même lorsque leur propre carrière progresse.
Le paradoxe des milieux privilégiés
Plus l’environnement est compétitif et visible, plus la jalousie s’intensifie. Dans la finance, le sport de haut niveau ou le monde des start-up, les écarts se mesurent en millions. Un trader gagnant 500 000 euros peut jalouser celui qui en gagne trois millions.
Ce phénomène, appelé relativité du succès, montre que l’abondance ne protège pas de la jalousie. Elle déplace simplement les critères de comparaison vers le haut.
L’effet loupe des algorithmes
Les algorithmes des plateformes aggravent le problème. Ils privilégient les contenus suscitant de l’engagement émotionnel, donc souvent spectaculaires ou enviables. Résultat : notre fil d’actualité devient une galerie ininterrompue de réussites qui ne sont pas les nôtres.
Sortir du piège : Repenser le succès
Comprendre les mécanismes de la privation relative et du contrôle social ne suffit pas. Encore faut-il agir.
Renforcer les liens authentiques. La théorie du contrôle social suggère que des attachements profonds réduisent le besoin de comparaison constante. Cultiver des relations où l’on est valorisé pour ce que l’on est, pas pour ce que l’on possède, offre un rempart contre la jalousie.
Redéfinir ses critères personnels. Plutôt que d’adhérer aveuglément aux définitions collectives du succès, identifier ce qui compte vraiment pour soi réduit la perception de privation. Vouloir gagner beaucoup d’argent parce que tout le monde le veut crée une insatisfaction structurelle.
Pratiquer la gratitude. De nombreuses recherches en psychologie positive montrent que noter régulièrement ce pour quoi on est reconnaissant diminue la focalisation sur ce qui manque. Cette pratique contrebalance la tendance naturelle à la comparaison ascendante.
Conclusion
La jalousie dans l’abondance n’est pas une contradiction : c’est la conséquence logique de mécanismes sociaux et psychologiques profonds. Tant que nous nous comparerons aux autres et que nous croirons en des idéaux de succès toujours plus exigeants, même les plus privilégiés resteront vulnérables à cette émotion.
La question n’est donc pas d’avoir plus, mais de regarder différemment. En prenant conscience des processus de privation relative et de contrôle social qui façonnent nos émotions, nous pouvons reprendre prise sur nos désirs et construire une satisfaction moins dépendante du regard d’autrui.
📚 POUR ALLER PLUS LOIN :
→ Les effets de l’habitus de Bourdieu sur nos choix de vie
→ Comment la socialisation construit nos désirs
→ Anomie et frustration sociale : comprendre Durkheim
💬 Partagez cet article si la sociologie éclaire votre quotidien.
FAQ
Qu’est-ce que la privation relative en sociologie ?
La privation relative désigne le sentiment de frustration ressenti lorsqu’un individu estime que sa situation est désavantageuse par rapport à celle d’autrui ou par rapport à ses propres attentes. Ce concept, développé par Samuel Stouffer dans les années 1940, montre que notre satisfaction dépend moins de ce que nous possédons objectivement que de l’écart perçu avec nos groupes de référence.
Pourquoi les réseaux sociaux augmentent-ils la jalousie ?
Les réseaux sociaux multiplient les occasions de comparaison sociale tout en ne montrant qu’une version sélectionnée et idéalisée de la vie des autres. Cette exposition permanente aux réussites d’autrui crée une norme de succès irréaliste et augmente la perception de privation relative, même chez les personnes objectivement privilégiées.
Comment la théorie du contrôle social explique-t-elle la jalousie ?
Selon Travis Hirschi, le contrôle social repose sur quatre piliers : attachement, engagement, implication et croyance. La jalousie apparaît comme un mécanisme de régulation sociale qui signale une menace sur ces piliers. Par exemple, voir un collègue réussir mieux menace notre engagement professionnel et déclenche une alerte émotionnelle.
Peut-on réduire la jalousie malgré l’abondance ?
Oui, en travaillant sur trois axes : renforcer des liens sociaux authentiques qui valorisent l’être plutôt que l’avoir ; redéfinir personnellement le succès en s’écartant des normes collectives automatiques ; pratiquer la gratitude pour réorienter l’attention vers ce que l’on possède plutôt que vers ce qui manque. La conscience des mécanismes sociologiques aide aussi à prendre du recul.
Bibliographie
- Hirschi, Travis. 1969. Causes of Delinquency. Berkeley : University of California Press.
- Stouffer, Samuel A. et al. 1949. The American Soldier: Adjustment During Army Life. Princeton : Princeton University Press.
- Festinger, Leon. 1954. « A Theory of Social Comparison Processes ». Human Relations, 7(2), p. 117-140.