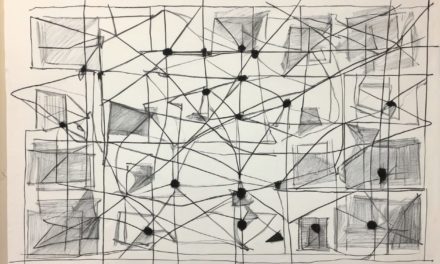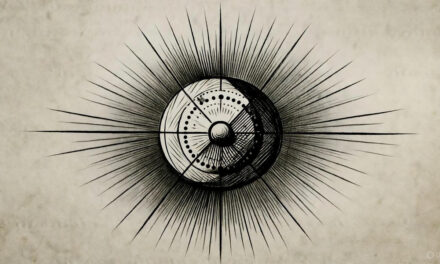En 2023, la France a connu une mobilisation massive contre la réforme des retraites. Des millions de travailleurs dans les rues, des grèves paralysant les transports, une colère contre le « mépris de classe ». Cette expression, revenue en force dans le débat public, trouve son origine dans une théorie vieille de 150 ans : le marxisme. Pourquoi les analyses de Karl Marx sur la division entre riches et pauvres, entre patrons et salariés, résonnent-elles encore aujourd’hui ?
Loin d’être une idéologie poussiéreuse, la théorie marxiste offre des outils puissants pour comprendre les tensions qui traversent nos sociétés. Division entre classes sociales, exploitation au travail, concentration des richesses : autant de réalités que Marx plaçait au cœur de son analyse du capitalisme. Explorons comment cette grille de lecture éclaire les conflits sociaux d’hier et d’aujourd’hui.
Table des matières
La société divisée : bourgeoisie contre prolétariat
Pour Marx, la société capitaliste repose sur une fracture fondamentale : l’opposition entre bourgeoisie et prolétariat. Cette division n’est pas une simple différence de revenus, mais une relation structurelle liée à la propriété des moyens de production.
La bourgeoisie, c’est la classe qui possède les usines, les entreprises, les terres agricoles, bref : tout ce qui permet de produire des richesses. Elle tire ses revenus non de son travail, mais de la propriété elle-même. Le patron d’usine ne fabrique pas les voitures : il détient l’usine et emploie ceux qui les fabriquent.
💡 DÉFINITION : Moyens de production
Ensemble des outils, machines, infrastructures et ressources nécessaires pour produire des biens et services. Selon Marx, leur propriété détermine les rapports de pouvoir dans la société.
Exemple : Une usine automobile, une plateforme numérique, des serveurs informatiques.
À l’inverse, le prolétariat désigne la classe ouvrière, ceux qui ne possèdent rien d’autre que leur force de travail. Pour survivre, ils doivent vendre leur temps et leur énergie à la bourgeoisie en échange d’un salaire. L’ouvrier, l’employé de bureau, le livreur à vélo : tous dépendent de leur employeur pour vivre.
Cette division crée un déséquilibre de pouvoir radical. La bourgeoisie contrôle l’économie, influence les décisions politiques et façonne les normes sociales. Le prolétariat, malgré sa force numérique, reste subordonné. Marx développe cette idée dans Le Capital (1867), montrant que ce rapport de domination est intrinsèque au capitalisme.
Classes sociales et conscience de classe
Marx distingue la classe en soi et la classe pour soi. Une classe sociale existe objectivement par sa position économique (classe en soi), mais elle ne devient véritablement actrice de l’histoire que lorsqu’elle prend conscience de ses intérêts communs (classe pour soi). Les grèves, les syndicats, les mouvements sociaux sont des manifestations de cette conscience de classe naissante.
L’histoire offre de nombreux exemples. Au XIXᵉ siècle, la Révolution industrielle concentre des milliers d’ouvriers dans des usines aux conditions épouvantables : journées de 14 heures, salaires misérables, absence de protection sociale. Face à l’exploitation, les travailleurs s’organisent en syndicats et lancent des grèves pour revendiquer des droits. Ces luttes aboutissent progressivement à des réformes : limitation du temps de travail, droit de grève, assurances sociales.
Comment le capitalisme génère l’exploitation
Pourquoi le capitalisme produit-il structurellement des conflits ? Marx répond avec le concept de plus-value, au cœur de sa critique économique.
Le mécanisme de l’exploitation
Imaginons un ouvrier qui fabrique des chaussures. En 8 heures de travail, il en produit 10 paires. Chaque paire se vend 50 euros, soit 500 euros de valeur créée. L’ouvrier reçoit un salaire de 100 euros pour sa journée. Où va la différence ?
Selon Marx, le capitaliste s’approprie la plus-value : la valeur produite par le travail de l’ouvrier au-delà de ce qui lui est reversé en salaire. Sur les 500 euros générés, 100 couvrent le salaire, 150 les coûts de production (matières premières, machines), et 250 euros constituent le profit du propriétaire. Ce profit n’est pas le fruit du travail du capitaliste, mais de l’exploitation du travail d’autrui.
📊 CHIFFRE-CLÉ
En France, la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises est passée de 74 % en 1982 à 68 % en 2020 (INSEE), illustrant une extraction croissante de plus-value au profit des détenteurs de capital.
Cette mécanique crée une tension permanente. Les capitalistes cherchent à maximiser leur profit en réduisant les coûts, notamment salariaux. Intensification du travail, pression sur les salaires, précarisation de l’emploi : autant de stratégies pour augmenter la plus-value extraite. Les travailleurs, de leur côté, luttent pour améliorer leurs conditions et leur rémunération. Le conflit est systémique, inscrit dans les fondements mêmes du capitalisme.
Inégalités et concentration des richesses
Cette extraction de plus-value produit mécaniquement des inégalités croissantes. La bourgeoisie accumule des richesses qui se transforment en nouveau capital, renforçant sa domination. Marx décrit ce processus dans sa théorie de l’accumulation capitaliste : le capital appelle le capital, creusant l’écart entre classes.
Les données contemporaines lui donnent raison. En 2023, les 1 % les plus riches détiennent 45 % du patrimoine mondial (Crédit Suisse), tandis que la moitié la plus pauvre en possède moins de 1 %. En France, le patrimoine moyen des 10 % les plus riches est 56 fois supérieur à celui des 50 % les plus pauvres (Observatoire des inégalités).
Ces inégalités se traduisent aussi en termes de pouvoir. Les grandes fortunes influencent les politiques publiques, possèdent les médias, financent les partis. Cette domination économique devient domination politique et culturelle, ce que Marx appelait la superstructure : l’idéologie dominante légitime l’ordre établi et rend l’exploitation acceptable.
Précarisation et nouvelles formes d’exploitation
Le capitalisme contemporain a inventé de nouvelles formes d’extraction de valeur. L’ubérisation en est l’exemple parfait : des travailleurs juridiquement « indépendants », sans protection sociale, payés à la tâche par des plateformes qui captent l’essentiel de la valeur créée. Le livreur Uber Eats qui pédale 10 heures par jour pour un revenu aléatoire incarne une précarisation qui rappelle les débuts du capitalisme industriel.
De même, l’externalisation permet aux entreprises de faire produire dans des pays à bas coûts salariaux, maximisant la plus-value extraite. Un smartphone assemblé en Chine pour quelques euros de main-d’œuvre se vend plusieurs centaines d’euros : l’écart illustre l’exploitation à l’échelle mondiale.
Le marxisme face aux inégalités du XXIᵉ siècle
La théorie marxiste, élaborée au XIXᵉ siècle, reste-t-elle pertinente pour comprendre notre époque ? La réponse est nuancée.
Pertinence renouvelée
La crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-19 ont ravivé l’intérêt pour Marx. Ces crises ont mis en lumière les dysfonctionnements du capitalisme : spéculation financière déconnectée de l’économie réelle, sauvetage des banques avec l’argent public, enrichissement des plus riches pendant que les classes populaires subissaient chômage et précarité.
Les mouvements sociaux contemporains réactivent des thématiques marxistes. Occupy Wall Street (2011) dénonçait le pouvoir des « 1 % ». Les Gilets jaunes (2018-2019) en France ont exprimé une révolte contre les inégalités et le sentiment de mépris de classe. Les grèves pour le climat portées par les jeunes générations interrogent un système économique fondé sur le productivisme et l’accumulation.
Ces mobilisations montrent que la conscience de classe n’a pas disparu, même si elle prend des formes nouvelles. Elle se combine avec d’autres luttes : féminisme, antiracisme, écologie. Le marxisme s’enrichit de ces apports, donnant naissance à des courants comme l’écomarxisme (critique du capitalisme destructeur de l’environnement) ou le féminisme matérialiste (analyse de l’exploitation spécifique des femmes dans le système capitaliste).
Limites et adaptations nécessaires
Le marxisme classique présente des limites. Il a sous-estimé le rôle des identités (genre, race, orientation sexuelle) dans les rapports de domination. Les inégalités ne se réduisent pas à la seule dimension de classe : une femme ouvrière subit une double exploitation (classe et genre), un travailleur immigré en subit une triple (classe, origine, statut administratif).
De plus, la vision d’une révolution prolétarienne renversant la bourgeoisie par la violence s’est heurtée aux réalités historiques. Les régimes se réclamant du marxisme (URSS, Chine maoïste) ont souvent sombré dans l’autoritarisme et n’ont pas créé de sociétés sans classes. Cette histoire tragique impose de repenser les moyens du changement social.
Enfin, le capitalisme a muté. L’essor des services, du numérique et de la finance complexifie la notion de classes. Où situer les travailleurs du savoir, les développeurs informatiques, les consultants ? La frontière entre bourgeoisie et prolétariat est parfois floue, même si la logique d’exploitation demeure : ceux qui possèdent les plateformes (Amazon, Google) accumulent des profits colossaux grâce au travail de millions d’employés et utilisateurs.
Qu’est-ce que ça change pour nous ?
Comprendre les mécanismes marxistes nous aide à décrypter les discours dominants. Quand on nous dit que « la croissance profite à tous » ou que « l’enrichissement des plus riches finira par ruisseler », Marx nous invite à questionner : qui produit la richesse ? Qui se l’approprie ? Ces questions restent brûlantes.
Elles éclairent aussi nos choix collectifs. Faut-il réguler davantage le capitalisme ? Renforcer les droits des travailleurs ? Repenser la propriété des moyens de production (coopératives, communs) ? Le marxisme ne donne pas de réponses toutes faites, mais il fournit des outils pour penser la transformation sociale.
Conclusion
La théorie marxiste de la lutte des classes nous rappelle que les inégalités ne sont pas des accidents, mais le produit d’un système économique fondé sur l’exploitation. Bourgeoisie et prolétariat, propriétaires et travailleurs : cette division structure encore nos sociétés, même sous des formes renouvelées.
Face aux crises actuelles, le marxisme retrouve une actualité. Il nous invite à ne pas accepter l’ordre établi comme une fatalité, mais à comprendre les rapports de pouvoir pour mieux les transformer. Et vous, comment percevez-vous ces divisions de classe dans votre quotidien ?
📚 POUR ALLER PLUS LOIN :
→ Max Weber et la stratification sociale : une autre vision des classes
→ Bourdieu et le capital : quand la culture devient domination
→ Inégalités économiques en France : chiffres et analyses
💬 Partagez cet article si la sociologie critique vous passionne !
FAQ
Qu’est-ce que la lutte des classes selon Marx ?
La lutte des classes désigne le conflit permanent entre la bourgeoisie (propriétaires des moyens de production) et le prolétariat (travailleurs vendant leur force de travail). Marx considère que ce conflit structure l’histoire des sociétés capitalistes et pousse au changement social. Les grèves, revendications salariales et mouvements sociaux en sont des manifestations concrètes.
Comment Marx définit-il les classes sociales ?
Pour Marx, les classes se définissent par leur rapport aux moyens de production. La bourgeoisie possède usines, terres et entreprises ; le prolétariat ne possède que sa force de travail. Cette division n’est pas qu’économique : elle détermine le pouvoir, l’accès aux ressources et la place dans la société. Elle diffère d’une simple hiérarchie de revenus.
Qu’est-ce que la plus-value dans la théorie marxiste ?
La plus-value est la valeur créée par le travail de l’ouvrier au-delà de son salaire. Si un travailleur produit 500 euros de valeur en une journée mais ne reçoit que 100 euros, les 400 euros restants (après coûts de production) constituent la plus-value appropriée par le capitaliste sous forme de profit. C’est le cœur de l’exploitation capitaliste.
Le marxisme est-il encore pertinent aujourd’hui ?
Oui, pour analyser les inégalités croissantes, la concentration des richesses et l’exploitation au travail (ubérisation, précarisation). Toutefois, il nécessite des adaptations pour intégrer d’autres dominations (genre, race) et penser de nouveaux modes de transformation sociale. Les crises récentes (2008, Covid-19) ont ravivé l’intérêt pour ses analyses du capitalisme.
Bibliographie
- Marx, Karl. 1867. Le Capital. Critique de l’économie politique – Livre I. Paris : Éditions Sociales (rééd. 1983).
- Marx, Karl et Engels, Friedrich. 1848. Le Manifeste du Parti communiste. Paris : Flammarion (rééd. 1998).
- Duménil, Gérard et Lévy, Dominique. 2003. Économie marxiste du capitalisme. Paris : La Découverte, coll. « Repères ».