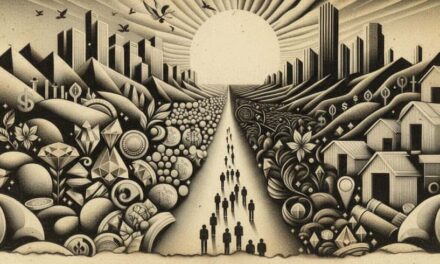Le 13 décembre 1937, les troupes japonaises pénètrent dans Nanjing, capitale de la République de Chine. Ce qui s’ensuivit demeure l’une des atrocités les plus documentées de la Seconde Guerre mondiale. Pendant six semaines, la population civile subit viols, tortures et exécutions de masse. Les estimations du nombre de victimes varient entre 40 000 et 300 000 personnes, selon les sources. Au-delà des chiffres contestés, le massacre de Nanjing pose une question fondamentale à la sociologie : comment comprendre la violence de masse ?
Cette tragédie ne relève pas simplement de l’histoire militaire. Elle interroge les mécanismes sociaux qui rendent possible l’impensable. Comment des individus ordinaires deviennent-ils acteurs de violence collective ? Quels processus sociologiques permettent la déshumanisation de l’autre ? Et pourquoi la mémoire de cet événement divise-t-elle encore aujourd’hui ? Cet article propose une analyse sociologique du massacre de Nanjing, en mobilisant les concepts de violence symbolique, de domination et de mémoire collective.
Table des matières
Qu’est-ce que la violence de masse ?
La violence de masse désigne les actes de violence physique commis de manière systématique contre un groupe humain. Elle se distingue des violences individuelles par son caractère organisé et collectif. Le sociologue allemand Max Weber définit l’État moderne comme détenteur du « monopole de la violence physique légitime ». Mais que se passe-t-il lorsque ce monopole est détourné pour perpétrer des crimes contre l’humanité ?
La philosophe Hannah Arendt, dans ses travaux sur le totalitarisme, montre que la violence de masse repose sur une bureaucratisation du meurtre. Les exécuteurs ne sont pas nécessairement des monstres, mais des individus insérés dans une structure qui normalise la violence. Cette banalité du mal, comme elle la nomme, caractérise les génocides et massacres du XXe siècle.
Le massacre de Nanjing illustre cette dynamique. Entre décembre 1937 et février 1938, l’armée impériale japonaise transforme une conquête militaire en entreprise de terreur systématique. Les soldats ne se contentent pas de neutraliser les combattants ennemis. Ils visent délibérément les civils, dans une logique de domination par la terreur. Cette violence n’est pas chaotique : elle s’inscrit dans une stratégie d’expansion impériale.
💡 DÉFINITION : Violence de masse
Actes de violence physique systématiques et organisés contre un groupe humain défini. Elle implique une dimension collective (plusieurs acteurs) et une logique structurelle (cadre institutionnel ou idéologique). Exemples historiques : génocides, massacres de guerre, terreur d’État.
À distinguer de : la violence symbolique, qui désigne l’imposition d’une domination sans recours à la force physique.
Le contexte historique est essentiel. Depuis 1931, le Japon occupe la Mandchourie et cherche à étendre son empire en Asie. Le 7 juillet 1937, l’incident du pont Marco Polo déclenche la seconde guerre sino-japonaise. Nanjing, capitale du gouvernement nationaliste de Tchang Kaï-chek, représente un objectif stratégique. Mais la prise de la ville en décembre 1937 dépasse largement les objectifs militaires.
Comment expliquer l’impensable ?
Pour comprendre le massacre de Nanjing, la sociologie mobilise plusieurs concepts. Le premier est la déshumanisation de l’ennemi. Les populations chinoises sont présentées dans la propagande japonaise comme inférieures, voire sous-humaines. Cette construction idéologique, que Pierre Bourdieu appellerait une forme de violence symbolique, précède et légitime la violence physique.
La violence symbolique désigne l’imposition d’une vision du monde qui naturalise la domination. Dans La Distinction(1979), Bourdieu montre comment les dominants imposent leurs normes culturelles comme universelles. Dans le contexte colonial et impérialiste japonais des années 1930, cette violence symbolique prend une dimension raciste. Les Chinois sont décrits comme une menace pour la « pureté » japonaise, justifiant leur élimination.
Cette déshumanisation ne s’opère pas dans un vide social. Elle s’inscrit dans une structure de domination militaire et politique. Les soldats japonais évoluent dans une institution totale, pour reprendre le concept du sociologue Erving Goffman. L’armée impériale impose une discipline stricte, une hiérarchie rigide et une obéissance absolue. Les ordres de terreur sont transmis par la chaîne de commandement, diluant la responsabilité individuelle.
Des témoignages historiques révèlent que certains officiers ont explicitement ordonné l’exécution de prisonniers de guerre et de civils. D’autres ont laissé faire, créant un climat de permissivité. Cette routinisation de la violence, analysée par Hannah Arendt, transforme des actes exceptionnels en pratiques quotidiennes. Les soldats s’habituent à tuer, à violer, à torturer. Le massacre devient une routine administrative.
La sociologie de Norbert Elias sur le processus de civilisation éclaire également ce phénomène. Elias montre que la violence n’a pas disparu des sociétés modernes : elle s’est concentrée dans les institutions étatiques. Mais en contexte de guerre totale, les mécanismes de contrôle de la violence se relâchent. Le massacre de Nanjing illustre cette décivilisation temporaire, où les normes sociales habituelles sont suspendues.
Le contexte économique et politique joue aussi un rôle. Le Japon traverse une crise économique dans les années 1930. Le gouvernement militariste cherche à résoudre cette crise par l’expansion territoriale et le pillage des ressources chinoises. Le massacre de Nanjing s’inscrit dans cette logique impérialiste : terroriser la population pour briser toute résistance et faciliter l’occupation.
Cette violence n’est donc pas irrationnelle. Elle obéit à une rationalité instrumentale, concept développé par Max Weber. Les dirigeants japonais calculent que la terreur massive découragera la résistance chinoise. C’est une violence stratégique, même si son exécution dépasse largement les objectifs initiaux. Cette dérive révèle la difficulté à contrôler la violence une fois déclenchée.
📊 CHIFFRE-CLÉ
Entre 40 000 et 300 000 victimes selon les sources. Le Tribunal de Tokyo (1946) retient le chiffre de 200 000 morts. La Chine officielle évoque 300 000 victimes. Ces écarts reflètent les enjeux politiques de la mémoire.
Quand l’histoire divise encore aujourd’hui
Le massacre de Nanjing ne s’est pas terminé en 1938. Il continue d’exister à travers la mémoire collective, concept développé par le sociologue Maurice Halbwachs. Selon Halbwachs, les souvenirs ne sont jamais purement individuels : ils se construisent socialement, dans des cadres collectifs. La mémoire du massacre diffère radicalement entre la Chine et le Japon.
En Chine, le massacre de Nanjing est devenu un symbole national de la résistance face à l’agression impérialiste. Des monuments commémoratifs ont été érigés, notamment le Mémorial de Nanjing inauguré en 1985. Chaque année, le 13 décembre, des cérémonies officielles rappellent cet événement. Cette mémoire institutionnalisée renforce l’identité nationale chinoise et justifie la méfiance persistante envers le Japon.
Au Japon, la mémoire est fragmentée et contestée. Certains historiens minimisent l’ampleur du massacre, contestant les chiffres officiels. D’autres nient purement et simplement l’événement. Ces positions, qualifiées de négationnisme historique, suscitent des tensions diplomatiques régulières avec la Chine. En 2004, le Tribunal pénal international qualifie pourtant le massacre de « crime contre l’humanité ».
Ces controverses révèlent une forme de violence symbolique contemporaine. En contestant ou minimisant le massacre, certains acteurs japonais perpétuent une domination symbolique sur la mémoire des victimes. Cette violence, bien que non physique, blesse les survivants et leurs descendants. Elle entretient les tensions entre les deux pays.
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a présenté des excuses en 2014, lors de la visite du président chinois Xi Jinping. Mais ces excuses restent controversées. Certains les jugent insuffisantes, d’autres les contestent. Cette difficulté à reconnaître le passé illustre ce que Bourdieu appellerait une lutte pour le monopole de la violence symbolique légitime. Qui a le pouvoir de dire ce qui s’est réellement passé ?
La sociologie nous rappelle que la mémoire n’est jamais neutre. Elle est un enjeu de pouvoir. Les groupes dominants tentent d’imposer leur version de l’histoire, tandis que les dominés luttent pour faire reconnaître leur souffrance. Le massacre de Nanjing demeure ainsi un champ de bataille mémoriel, où s’affrontent des visions du monde incompatibles.
Conclusion
Le massacre de Nanjing n’est pas qu’un événement historique lointain. Il interroge notre compréhension de la violence de masse et de ses mécanismes sociologiques. La déshumanisation, la structure militaire, la violence symbolique et la mémoire collective sont autant de concepts qui éclairent cette tragédie. Comprendre sociologiquement ces processus n’excuse rien, mais permet de mieux saisir comment l’impensable devient possible.
Ces mécanismes ne sont pas propres à 1937. Ils opèrent dans d’autres contextes de violence de masse, des génocides aux guerres contemporaines. La sociologie nous invite à une vigilance constante : identifier les discours de déshumanisation, questionner les structures de domination, résister à la banalisation de la violence. Comment nos sociétés peuvent-elles prévenir de telles atrocités ?
📚 POUR ALLER PLUS LOIN :
→ La violence symbolique théorisée par Bourdieu : comprendre l’imposition des normes dominantes
→ Comprendre les mécanismes de domination selon Pierre Bourdieu : analyse des rapports de pouvoir
→ La construction de la mémoire collective selon Maurice Halbwachs : comment les sociétés se souviennent
💬 Partagez cet article pour diffuser une compréhension sociologique des violences de masse.
FAQ
Combien de victimes le massacre de Nanjing a-t-il fait ?
Les estimations varient considérablement, entre 40 000 et 300 000 victimes selon les sources. Le Tribunal de Tokyo (1946) retient environ 200 000 morts. La Chine officielle évoque 300 000 victimes. Ces écarts reflètent autant des difficultés méthodologiques (destruction de documents, chaos de la guerre) que des enjeux politiques de mémoire.
Pourquoi parle-t-on encore du massacre de Nanjing aujourd’hui ?
La mémoire du massacre reste vive pour deux raisons. D’abord, elle structure l’identité nationale chinoise comme symbole de résistance à l’impérialisme. Ensuite, les controverses historiographiques au Japon (minimisation ou négation) alimentent les tensions diplomatiques sino-japonaises. Le massacre demeure un enjeu géopolitique majeur en Asie de l’Est.
Comment la sociologie explique-t-elle la violence de masse ?
La sociologie mobilise plusieurs concepts : la déshumanisation de l’ennemi (construction idéologique), la structure institutionnelle (armée, État), la violence symbolique (légitimation de la domination), et la banalité du mal (routinisation des actes violents). Ces mécanismes montrent que la violence de masse n’est pas irrationnelle, mais s’inscrit dans des logiques sociales et politiques.
Quelle est la différence entre violence symbolique et violence physique ?
La violence physique désigne l’usage de la force corporelle (coups, blessures, meurtre). La violence symbolique, concept de Pierre Bourdieu, désigne l’imposition d’une vision du monde qui naturalise la domination, sans recours à la force. Elle passe par le langage, l’éducation, les institutions. Dans le cas de Nanjing, la violence symbolique (déshumanisation) a précédé et légitimé la violence physique (massacre).
Le massacre de Nanjing peut-il être qualifié de génocide ?
Juridiquement, le terme génocide (défini en 1948) désigne la destruction intentionnelle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le massacre de Nanjing est généralement qualifié de crime contre l’humanité ou de crime de guerre, car il visait une population dans un contexte militaire plutôt qu’une volonté d’extermination totale d’un groupe. Cette distinction demeure débattue parmi les historiens.
Bibliographie
- Arendt, Hannah. 1963. Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal. Paris : Gallimard.
- Bourdieu, Pierre. 1979. La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris : Éditions de Minuit.
- Weber, Max. 1919. Le Savant et le Politique. Paris : La Découverte.
- Halbwachs, Maurice. 1950. La Mémoire collective. Paris : Presses Universitaires de France.
- Chang, Iris. 1997. The Rape of Nanking : The Forgotten Holocaust of World War II. New York : Basic Books.
Article rédigé par Élisabeth de Marval | 2 novembre 2025 | Sociologie de la violence