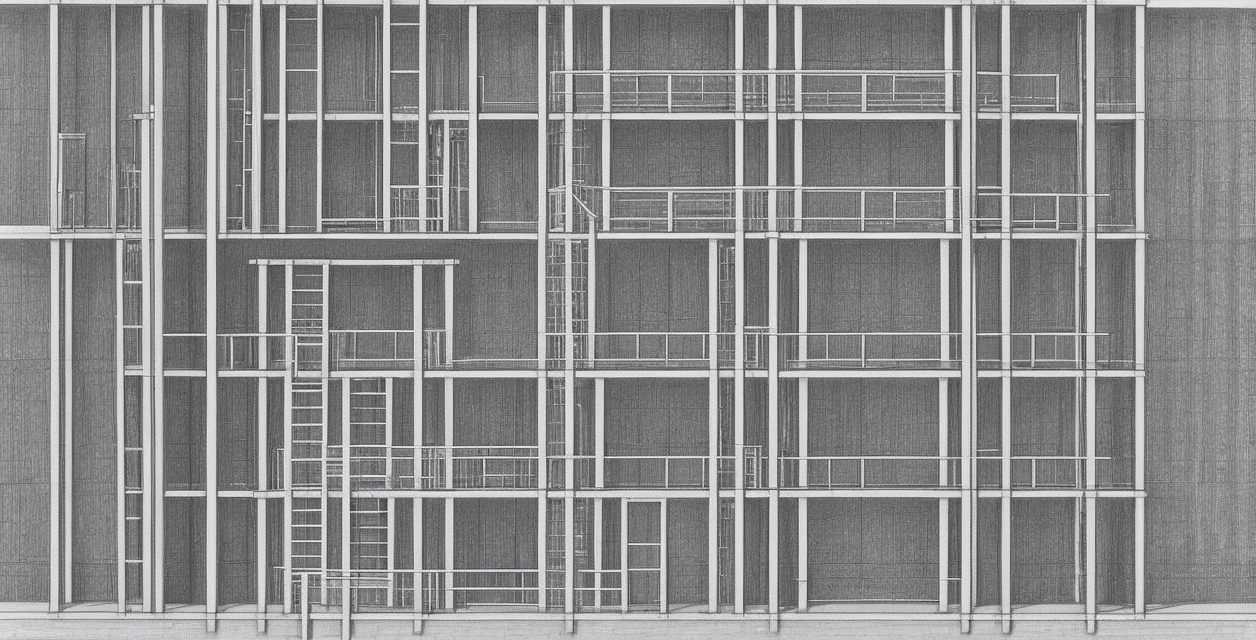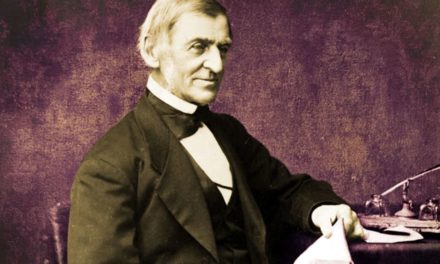Paris, 1871. La Commune vient d’être écrasée dans un bain de sang. Pourtant, dans les ruines fumantes, une idée refuse de mourir : celle d’une société sans maîtres ni esclaves. Cette utopie porte un nom qui fait encore trembler les gouvernements deux siècles plus tard : l’anarchisme.
Mais que cache vraiment ce mot ? Entre fantasme révolutionnaire et projet politique structuré, l’anarchisme est l’une des philosophies les plus incomprises de l’histoire moderne. De Proudhon à Bakounine, de la Catalogne républicaine aux collectifs autogérés d’aujourd’hui, explorons les racines et les visages multiples d’une pensée qui refuse l’autorité.
Table des matières
L’anarchisme en trois mots : liberté, égalité, autonomie
Commençons par tordre le cou à un mythe tenace. L’anarchisme n’est pas le chaos. Étymologiquement, « anarchie » vient du grec an-arkhos : « sans chef », pas « sans règles ». Les anarchistes ne rêvent pas d’un monde de violence généralisée, mais d’une organisation sociale fondée sur la coopération volontaire plutôt que sur la contrainte.
Au cœur de cette philosophie : le rejet radical de toute hiérarchie imposée. L’État, le capitalisme, le patriarcat – toutes les structures qui placent certains humains au-dessus d’autres sont considérées comme illégitimes. À la place, les anarchistes imaginent des communautés autogérées où chaque individu participe directement aux décisions qui affectent sa vie.
💡 DÉFINITION : Anarchisme
Philosophie politique prônant l’abolition de l’État et de toute autorité coercitive au profit d’une société fondée sur la libre association, l’entraide mutuelle et l’autonomie individuelle.
Exemple : Les collectivités agricoles autogérées pendant la guerre civile espagnole (1936-1939).
Cette vision n’est pas née dans un vide. Elle émerge au XIXe siècle en Europe, période de bouleversements industriels violents. Usines insalubres, journées de 14 heures, travail des enfants : le capitalisme naissant broie les ouvriers. Parallèlement, les révolutions de 1789 et 1848 ont montré que renverser un tyran ne suffit pas – un nouvel État peut être tout aussi oppressif.
Les pères fondateurs : de Proudhon à Goldman
Pierre-Joseph Proudhon : « La propriété, c’est le vol ! »
En 1840, un modeste typographe français lâche une bombe intellectuelle. Dans Qu’est-ce que la propriété ?, Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) affirme que la propriété privée des moyens de production est un vol légalisé. Scandalisé par les conditions des ouvriers, il développe une vision mutualiste où coopératives et fédérations remplaceraient l’État.
Proudhon pose les fondations : l’anarchisme n’est pas le désordre, mais une organisation volontaire « du bas vers le haut ». Son idée centrale ? Les êtres humains n’ont pas besoin d’un pouvoir centralisé pour vivre ensemble – ils peuvent s’organiser librement par contrats mutuels.
Mikhaïl Bakounine : la révolution par l’action directe
Si Proudhon théorise, Mikhaïl Bakounine (1814-1876) incarne l’anarchisme révolutionnaire. Ce noble russe participe à tous les soulèvements européens de son époque. Pour lui, l’État – même « socialiste » – restera toujours un instrument de domination. Sa rupture fracassante avec Karl Marx lors de la Première Internationale (1872) oppose deux visions irréconciliables : dictature du prolétariat contre abolition immédiate de l’État.
Bakounine introduit l’idée de « propagande par le fait » – l’action directe comme outil de conscientisation. Son influence sur les mouvements ouvriers européens sera considérable.
Emma Goldman : féminisme et libre pensée
Emma Goldman (1869-1940), anarchiste lituanienne exilée aux États-Unis, incarne l’élargissement de la critique anarchiste. Pour elle, l’oppression ne se limite pas à l’État et au capital : elle traverse aussi les rapports de genre, la religion, la morale sexuelle.
Goldman lie anarchisme et émancipation des femmes. Elle défend le droit à la contraception (scandaleux en 1900), critique le mariage comme institution de domination, et milite pour la « libre pensée ». Son héritage : l’anarchisme n’est pas qu’économique, il est aussi culturel et existentiel.
Errico Malatesta : l’anarchisme communiste
L’Italien Errico Malatesta (1853-1932) développe la branche communiste-libertaire. Contrairement aux mutualistes, il rejette tout système monétaire. Sa vision : une société où chacun contribue selon ses capacités et reçoit selon ses besoins, sans État pour imposer cette égalité.
Malatesta insiste sur un point crucial : l’anarchisme ne peut se construire que par la volonté collective. Aucune avant-garde éclairée ne peut imposer la liberté – c’est une contradiction dans les termes.
Cinq visions pour un monde sans maîtres
L’anarchisme n’est pas monolithique. Derrière le rejet commun de l’autorité coexistent plusieurs stratégies et priorités. Voici les principales écoles de pensée.
L’anarchisme individualiste : l’unique contre tous
Porté par le philosophe allemand Max Stirner, l’anarchisme individualiste radicalise l’autonomie personnelle. Chaque individu est « unique » et ne doit allégeance à aucune institution, pas même à des idéaux abstraits comme « l’humanité » ou « la justice ».
Cette branche attire ceux qui refusent toute contrainte collective. Critiquée pour son potentiel élitiste, elle influence néanmoins le mouvement libertarien américain et certaines formes de résistance culturelle.
L’anarchisme collectiviste : la propriété commune
Les collectivistes, héritiers de Bakounine, proposent la propriété collective des moyens de production. Les usines, les terres, les outils appartiennent à tous. Mais contrairement aux communistes, la distribution des biens se fait selon le travail fourni, pas selon les besoins.
Ce modèle inspire les premières coopératives ouvrières et les syndicats révolutionnaires du début du XXe siècle.
L’anarcho-syndicalisme : le syndicat comme arme
L’anarcho-syndicalisme fusionne lutte sociale et organisation ouvrière. Les syndicats ne se contentent pas de négocier des salaires : ils préparent la grève générale qui renversera le capitalisme. Une fois l’État et le patronat abattus, ces syndicats géreront directement la production.
Cette stratégie connaît son apogée en Espagne avec la CNT (Confédération Nationale du Travail), qui regroupe plus d’un million de membres en 1936.
L’anarchisme social : communauté et solidarité
Les anarchistes sociaux, influencés par Pierre Kropotkine et son concept d’entraide mutuelle, mettent l’accent sur la solidarité communautaire. Ils s’opposent à l’individualisme radical et insistent : la liberté personnelle n’a de sens que dans une société égalitaire et fraternelle.
Cette branche alimente les réflexions sur les communs, l’économie solidaire et les ZAD (Zones À Défendre) contemporaines.
L’anarchisme vert : écologie et décroissance
Apparu dans les années 1970, l’éco-anarchisme ou anarchisme vert relie crise écologique et domination hiérarchique. Le capitalisme et l’État détruisent la planète en exploitant humains et nature de la même manière brutale.
Les éco-anarchistes prônent des modes de vie décroissants, la réappropriation des savoirs paysans, et la création de communautés autonomes en harmonie avec les écosystèmes. Ils inspirent les mouvements d’écologie radicale actuels.
Au-delà des étiquettes : un combat commun
Malgré leurs différences, toutes ces écoles partagent un socle inébranlable : aucune domination n’est légitime. Que cette domination soit économique (capitalisme), politique (État), sociale (patriarcat) ou écologique (extractivisme), elle doit être combattue.
Les anarchistes se distinguent aussi des autres courants révolutionnaires sur un point crucial : le refus des moyens autoritaires. On ne construit pas une société libre par la dictature, même « provisoire ». C’est leur principale divergence avec les marxistes-léninistes, qui acceptent l’État transitoire.
Cette cohérence entre fins et moyens explique pourquoi l’anarchisme reste une référence pour de nombreux mouvements sociaux contemporains : féminisme radical, écologie directe, luttes anticarcérales, autonomie indigène.
Pour aller plus loin
→ Découvrez comment la domination sociale se reproduit dans nos sociétés modernes
→ Explorez les différences entre marxisme et anarchisme dans la pensée révolutionnaire
→ Analysez les nouveaux mouvements sociaux qui s’inspirent de l’anarchisme
💬 Cet article vous aide à comprendre l’anarchisme ? Partagez-le !
FAQ
Qu’est-ce que l’anarchisme en une phrase ?
L’anarchisme est une philosophie politique qui prône l’abolition de l’État et de toute hiérarchie au profit d’une société fondée sur la coopération volontaire, l’autonomie individuelle et l’égalité sociale. Contrairement au mythe du chaos, les anarchistes proposent une organisation « par le bas », sans pouvoir centralisé.
L’anarchisme est-il de gauche ou de droite ?
L’anarchisme historique est clairement à gauche : il critique le capitalisme, défend l’égalité sociale et s’allie aux mouvements ouvriers. Cependant, certains courants « anarcho-capitalistes » (surtout aux États-Unis) se réclament de la droite libertarienne. La plupart des anarchistes rejettent cette filiation, considérant que capitalisme et liberté sont incompatibles.
Pourquoi les anarchistes refusent-ils le communisme d’État ?
Les anarchistes et les communistes marxistes partagent la critique du capitalisme mais divergent radicalement sur la stratégie. Pour les anarchistes, l’État – même « ouvrier » – reste un instrument de domination. Ils rejettent l’idée d’une « dictature du prolétariat » transitoire, estimant que tout pouvoir centralisé finit par se reproduire (comme l’a montré l’URSS).
Existe-t-il des sociétés anarchistes aujourd’hui ?
Aucun pays entier ne fonctionne sur un modèle anarchiste. Mais des expériences locales existent : le Chiapas zapatiste au Mexique (depuis 1994), le Rojava en Syrie (depuis 2012), ou encore des milliers de coopératives et de collectifs autogérés à travers le monde. Ces exemples montrent que l’organisation sans État est possible à certaines échelles.
Les anarchistes sont-ils violents ?
L’anarchisme en tant que philosophie ne prescrit ni la violence ni la non-violence. Certains anarchistes sont pacifistes, d’autres estiment que la violence défensive contre l’oppression est légitime. Historiquement, quelques attentats anarchistes (fin XIXe) ont marqué les esprits, mais la majorité des actions anarchistes sont non-violentes : grèves, occupations, créations de communs.
Bibliographie
- Proudhon, Pierre-Joseph. 1840. Qu’est-ce que la propriété ?. Paris : J.-F. Brocard.
- Bakounine, Mikhaïl. 1870. L’Empire knouto-germanique et la Révolution sociale.
- Goldman, Emma. 1910. Anarchism and Other Essays. New York : Mother Earth Publishing.
- Kropotkine, Pierre. 1902. L’Entraide : un facteur de l’évolution. Paris : Hachette.
Article rédigé par Élisabeth de Marval | Novembre 2025 | Philosophie politique