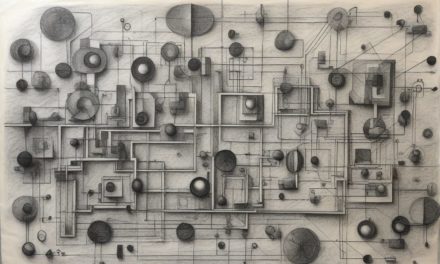À l’heure où les conteneurs s’immobilisent et les usines se relocalisent, un nouveau paradigme s’impose sur l’échiquier mondial. Le nationalisme économique, longtemps relégué aux oubliettes de l’histoire, fait un retour fracassant dans les chancelleries occidentales comme dans les discours politiques. De Washington à Pékin, des voix souverainistes s’élèvent pour réinventer un monde que l’on croyait définitivement globalisé. Ce n’est plus un tabou : les États reprennent la main sur des économies trop longtemps abandonnées aux seules forces du marché. Derrière cette révolution silencieuse se joue bien plus qu’une simple guerre commerciale – c’est l’avenir de notre contrat social et de nos démocraties qui se dessine dans ce grand basculement.
Table des matières
Introduction : Aux origines d’une transformation mondiale
Dans les salles feutrées du Forum économique mondial de Davos, en janvier 2022, un constat s’impose entre les lignes des discours officiels : la mondialisation telle qu’elle s’est construite depuis les années 1990 arrive à son terme. Ce n’est plus seulement l’apanage des discours altermondialistes ou des mouvements contestataires. Désormais, les architectes mêmes du système mondial l’admettent à demi-mot. Nous assistons à un phénomène d’une ampleur rarement observée dans l’histoire économique moderne : le retour en force du nationalisme économique, porté non plus uniquement par les États traditionnellement protectionnistes, mais également par ceux qui furent les chantres du libre-échange sans entrave. Ce virage spectaculaire s’incarne parfaitement dans la confrontation sino-américaine, véritable épicentre de ce séisme géopolitique et économique.
Relocalisation : quand le nationalisme économique redonne du sens au travail local.
Ce revirement ne s’est pas produit du jour au lendemain. Il est la conséquence d’une série de crises successives qui ont ébranlé les certitudes idéologiques des trois dernières décennies. De la crise financière de 2008 à la pandémie de Covid-19, en passant par les tensions commerciales croissantes entre la Chine et les États-Unis, l’édifice néolibéral s’est fissuré sous l’effet de ses propres contradictions. Les populations occidentales, confrontées à la désindustrialisation, à la stagnation des salaires et à la précarisation du travail, ont progressivement retiré leur consentement tacite à un modèle économique qui semblait profiter davantage aux multinationales qu’aux citoyens ordinaires. Le consensus de Washington, ce corpus de principes économiques prônant la libéralisation, la privatisation et la dérégulation, a perdu de sa superbe.
La mondialisation est morte, le nationalisme économique l’a tuée
Au cœur de cette reconfiguration mondiale se trouve un affrontement économique d’une intensité inédite entre les États-Unis et la Chine. Ce qui avait commencé comme une simple « guerre commerciale » sous l’administration Trump s’est progressivement transformé en une compétition stratégique globale impliquant technologies de pointe, chaînes d’approvisionnement et souveraineté économique. Les deux superpuissances mobilisent désormais toute la palette des instruments étatiques pour sécuriser leurs avantages compétitifs : subventions massives, contrôle des investissements étrangers, restrictions à l’exportation des technologies sensibles, politiques industrielles ambitieuses. Loin d’être de simples ajustements tactiques, ces mesures traduisent une remise en question fondamentale du paradigme économique dominant depuis la chute du Mur de Berlin.
Ce qui rend ce moment historique particulièrement fascinant est son caractère ambivalent. D’un côté, le nationalisme économique peut légitimement susciter des inquiétudes quant à la fragmentation de l’économie mondiale, au risque d’escalade des tensions commerciales et à la résurgence de rhétoriques xénophobes. De l’autre, cette reconfiguration pourrait ouvrir un espace pour repenser les modes de gouvernance économique, rééquilibrer les relations entre États et marchés, et restaurer la capacité des démocraties à mettre l’économie au service du bien commun. La frontière entre souverainisme économique légitime et nationalisme économique agressif est ténue, mais cruciale pour comprendre les enjeux de cette transition.
L’objet de cette analyse est précisément d’explorer cette zone d’ambiguïté et d’examiner les implications profondes de ce changement de paradigme. Comment distinguer le souverainisme économique, défensif et orienté vers la résilience nationale, du nationalisme économique potentiellement conflictuel ? Dans quelle mesure la compétition sino-américaine reconfigure-t-elle l’ordre économique international ? La remise en cause de la mondialisation néolibérale peut-elle constituer une opportunité pour revitaliser les démocraties et construire des modèles économiques plus inclusifs ? Ces questions se situent au carrefour de l’économie politique, des relations internationales et de la théorie démocratique.
La rivière qui s’écoule dans trop de canaux finit par assécher son lit principal.
Notre hypothèse est que nous traversons actuellement une période de transition systémique, comparable par son ampleur à celle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale ou la chute du bloc soviétique. Cette transition est marquée par un rééquilibrage entre l’hypermondialisation des trois dernières décennies et les impératifs de sécurité nationale, de cohésion sociale et de soutenabilité environnementale. Dans ce contexte, les États-nations retrouvent une centralité qu’ils semblaient avoir perdue, non pas comme reliques d’un passé révolu, mais comme espaces politiques où peuvent se reconstruire des compromis sociaux et écologiques adaptés aux défis du XXIe siècle.
Ce renouveau du rôle de l’État dans l’économie s’accompagne nécessairement d’une réflexion sur la nature des régimes politiques les plus à même de piloter cette transition. La confrontation sino-américaine n’est pas seulement économique, elle est aussi idéologique, opposant deux visions antagonistes de l’organisation politique et sociale : d’un côté, un capitalisme autoritaire centralisé incarné par la Chine, de l’autre, un modèle occidental en pleine redéfinition, oscillant entre renouveau démocratique et tentations illibérales. L’issue de cette compétition déterminera en grande partie l’équilibre des puissances au XXIe siècle, mais aussi les modes de gouvernance qui structureront l’économie mondiale dans les décennies à venir.
Contexte historique et théorique : Les métamorphoses du nationalisme économique
Des mercantilistes à l’hypermondialisation : une histoire cyclique
Le nationalisme économique, loin d’être une anomalie historique, constitue en réalité une constante dans l’évolution du capitalisme moderne. Depuis les politiques mercantilistes du XVIIe siècle jusqu’aux programmes industriels contemporains, l’intervention de l’État dans l’économie pour favoriser les intérêts nationaux a connu des périodes d’expansion et de contraction, dessinant un mouvement pendulaire entre protectionnisme et libre-échange.
Au XVIIIe siècle, alors que l’Angleterre consolidait sa suprématie navale et commerciale, les théoriciens mercantilistes comme Jean-Baptiste Colbert en France développaient des stratégies économiques centrées sur la puissance de l’État. L’accumulation de métaux précieux, le développement des manufactures nationales et la protection des industries naissantes constituaient les piliers de cette approche. Un exemple emblématique fut la création de la Manufacture royale des Glaces de Saint-Gobain en 1665, destinée à concurrencer la domination vénitienne dans ce secteur stratégique. Cette politique industrielle avant l’heure illustre déjà la logique fondamentale du nationalisme économique : l’État mobilise ses ressources pour créer des avantages compétitifs nationaux dans des secteurs considérés comme stratégiques.
La guerre commerciale sino-américaine n’est que la partie émergée du nationalisme économique.
Le XIXe siècle, souvent présenté comme l’âge d’or du libéralisme économique, fut en réalité traversé par d’intenses débats sur le protectionnisme. Aux États-Unis, Alexander Hamilton élabora dès 1791 son « Rapport sur les manufactures », véritable manifeste pour une politique industrielle active. L’économiste allemand Friedrich List, observant le retard de son pays face à l’industrialisation britannique, développa en 1841 sa théorie du « protectionnisme éducateur » dans son ouvrage « Système national d’économie politique ». Selon lui, les nations en développement devaient protéger temporairement leurs industries naissantes avant de pouvoir s’ouvrir à la concurrence internationale. Cette idée fondatrice continue d’influencer les stratégies de développement économique jusqu’à nos jours, notamment en Asie de l’Est.
La période 1945-1970 constitue un moment particulièrement instructif pour notre analyse. Après les désastres du nationalisme économique agressif des années 1930, les architectes de l’ordre économique d’après-guerre cherchèrent à construire un système international favorisant le commerce, mais intégrant également des mécanismes de protection nationale. Ce « libéralisme enchâssé », selon l’expression de l’économiste John Gerard Ruggie, reposait sur un compromis fondamental : les États acceptaient une ouverture progressive de leurs économies en échange de la préservation de leur autonomie en matière de politique intérieure et de protection sociale. Les accords de Bretton Woods, avec leur système de taux de change fixes et leur encadrement des mouvements de capitaux, illustrent parfaitement cette approche équilibrée. Cette période, souvent qualifiée d' »âge d’or du capitalisme », se caractérisa par une croissance économique soutenue, une réduction des inégalités et une expansion des systèmes de protection sociale dans les pays développés.
La mondialisation nous avait promis la paix par le commerce. Le nationalisme économique prépare le commerce par la guerre.
Le tournant néolibéral des années 1980, incarné par Margaret Thatcher au Royaume-Uni et Ronald Reagan aux États-Unis, amorça une rupture avec ce modèle d’équilibre. La libéralisation des marchés financiers, l’affaiblissement des syndicats, les privatisations massives et la déréglementation généralisée créèrent les conditions d’une mondialisation accélérée, qui atteignit son apogée dans les années 1990-2000. La chute du bloc soviétique semblait confirmer le triomphe définitif du capitalisme libéral, promettant une convergence progressive de toutes les économies vers le modèle occidental. Cette période d’hypermondialisation se caractérisa par l’intégration croissante de la Chine dans l’économie mondiale, symbolisée par son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce en 2001.
Cependant, ce consensus néolibéral commença à se fissurer dès la fin des années 2000. La crise financière de 2008 révéla les fragilités d’un système économique excessivement financiarisé et globalisé. Les politiques d’austérité qui suivirent, notamment en Europe, accentuèrent le mécontentement social et nourrirent la montée des mouvements populistes. La pandémie de Covid-19 acheva de démontrer les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement mondiales et la dépendance excessive de nombreux pays occidentaux vis-à-vis de la production chinoise, notamment dans des secteurs stratégiques comme les équipements médicaux ou les composants électroniques.
Ce bref panorama historique révèle une constante fondamentale : le nationalisme économique n’est jamais totalement absent des stratégies nationales, même dans les périodes de libéralisation intense. Il évolue, se transforme, mais persiste comme un élément structurant des relations économiques internationales. Son retour actuel n’est donc pas tant une anomalie qu’une réaffirmation de cette tendance cyclique, amplifiée par des circonstances géopolitiques spécifiques.
Le cadre théorique : entre réalisme économique et institutionnalisme
Pour saisir la complexité du nationalisme économique contemporain, il est nécessaire de mobiliser plusieurs cadres théoriques complémentaires. Le réalisme économique, dérivé du réalisme en relations internationales, considère l’économie comme un domaine de compétition entre États cherchant à maximiser leur puissance relative. Dans cette perspective, les politiques commerciales et industrielles sont avant tout des instruments de la stratégie nationale. Cette approche, défendue notamment par Robert Gilpin dans son ouvrage « The Political Economy of International Relations » (1987), permet de comprendre la dimension sécuritaire des choix économiques actuels, particulièrement visible dans la confrontation sino-américaine.
L’institutionnalisme historique offre un angle complémentaire, en soulignant l’importance des trajectoires nationales et des arrangements institutionnels spécifiques dans la définition des politiques économiques. Les travaux de Peter Hall et David Soskice sur les « variétés du capitalisme » montrent que les économies nationales ne convergent pas nécessairement vers un modèle unique, mais conservent des caractéristiques institutionnelles distinctes qui façonnent leurs avantages comparatifs. Cette approche nous aide à comprendre pourquoi la Chine et les États-Unis développent des formes de nationalisme économique différentes, ancrées dans leurs traditions politiques et leurs structures institutionnelles respectives.
Réindustrialisation nationale : quand le droit au travail redevient une priorité politique.
Enfin, l’économie politique internationale critique, représentée par des auteurs comme Dani Rodrik ou Joseph Stiglitz, nous invite à examiner les tensions entre mondialisation économique et démocratie nationale. Selon ce courant, l’hypermondialisation des dernières décennies a créé un « trilemme politique » : il est impossible de concilier simultanément une intégration économique profonde, une souveraineté nationale significative et des processus démocratiques robustes. Cette analyse éclaire les dilemmes auxquels sont confrontés les gouvernements contemporains et explique en partie le regain d’intérêt pour les politiques économiques nationales comme moyens de restaurer un espace de décision démocratique.
Ces cadres théoriques nous permettent d’identifier trois dimensions essentielles du nationalisme économique contemporain : sa dimension sécuritaire (protection des intérêts stratégiques nationaux), sa dimension institutionnelle (préservation des arrangements sociaux spécifiques) et sa dimension démocratique (restauration d’un espace de délibération collective sur les choix économiques). C’est à travers ces trois prismes que nous analyserons la confrontation sino-américaine et ses implications pour l’ordre économique mondial.
Analyse approfondie : La confrontation sino-américaine comme laboratoire du nouveau nationalisme économique
De la guerre commerciale à la compétition technologique globale
Ce qui a commencé en 2018 comme une série de mesures tarifaires américaines ciblant les importations chinoises s’est rapidement transformé en un affrontement multidimensionnel englobant technologies, investissements, propriété intellectuelle et sécurité nationale. Cette escalade illustre parfaitement la mutation du nationalisme économique contemporain : il ne s’agit plus seulement de protéger des secteurs industriels traditionnels, mais de sécuriser des avantages compétitifs dans les technologies d’avenir qui détermineront la hiérarchie des puissances au XXIe siècle.
L’administration Trump a initié ce tournant en imposant des droits de douane sur environ 360 milliards de dollars d’importations chinoises, justifiant ces mesures par la nécessité de réduire le déficit commercial américain et de sanctionner les « pratiques commerciales déloyales » de la Chine. Beijing a répliqué par des mesures similaires, ciblant notamment les exportations agricoles américaines. Au-delà de cette guerre tarifaire médiatisée, des mesures plus structurelles ont été mises en place : renforcement du Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) pour bloquer les acquisitions chinoises dans les secteurs sensibles, restrictions sur le transfert de technologies américaines, pressions sur les alliés pour exclure Huawei des infrastructures 5G.
Les puissances qui perdent leur souveraineté économique perdent d’abord leur voix, puis leur choix.
L’administration Biden, loin de revenir sur cette orientation, l’a approfondie et systématisée. Le CHIPS and Science Act de 2022, qui alloue 52 milliards de dollars de subventions à l’industrie américaine des semi-conducteurs, illustre cette continuité bipartisane. Ces mesures ne visent plus simplement à rééquilibrer les échanges commerciaux, mais à reconstruire des capacités industrielles nationales dans des secteurs considérés comme stratégiques : semi-conducteurs avancés, batteries, terres rares, intelligence artificielle, biotechnologies. L’objectif est explicitement géopolitique : maintenir l’avance technologique américaine face à la montée en puissance chinoise.
Du côté chinois, le nationalisme économique s’inscrit dans une tradition étatiste plus ancienne, mais a connu une intensification notable sous la présidence de Xi Jinping. Le programme « Made in China 2025 », lancé en 2015, vise à faire de la Chine un leader mondial dans dix secteurs technologiques clés. Face aux restrictions américaines, Beijing a accéléré sa stratégie de « double circulation », qui cherche à réduire la dépendance aux marchés et technologies étrangers tout en maintenant une présence active dans l’économie mondiale. Les investissements massifs dans les semi-conducteurs (plus de 150 milliards de dollars sur dix ans) illustrent cette volonté d’autonomie technologique.
Cette confrontation technologique se déploie également dans l’espace normatif. Les deux puissances cherchent à imposer leurs standards dans les technologies émergentes, conscientes que la maîtrise des normes techniques confère un avantage compétitif décisif. La Chine a considérablement renforcé sa présence dans les organismes internationaux de normalisation comme l’Union internationale des télécommunications (UIT) ou l’Organisation internationale de normalisation (ISO), tandis que les États-Unis tentent de coordonner une approche alternative avec leurs alliés, notamment à travers des initiatives comme le « Partenariat pour la sécurité des télécommunications » ou le « Cadre économique pour l’Indo-Pacifique ».
L’économie souverainiste, c’est le pouvoir rendu aux communautés locales et non aux multinationales.
Le cas des semi-conducteurs cristallise parfaitement ces enjeux. Ces composants électroniques, essentiels au fonctionnement de toutes les technologies modernes, sont devenus le symbole de la compétition sino-américaine. L’industrie des semi-conducteurs se caractérise par une chaîne de valeur extrêmement complexe et mondialisée : la conception est dominée par les entreprises américaines (Intel, Qualcomm, Nvidia), la fabrication des puces les plus avancées par l’entreprise taïwanaise TSMC, tandis que les équipements de production les plus sophistiqués sont fournis par l’entreprise néerlandaise ASML. Face à cette interdépendance, les États-Unis ont adopté une stratégie double : renforcer leurs capacités nationales tout en mobilisant leurs alliés pour restreindre l’accès de la Chine aux technologies les plus avancées. Les restrictions à l’exportation imposées en octobre 2022, qui limitent drastiquement l’accès chinois aux semi-conducteurs avancés et aux équipements de fabrication, illustrent cette approche coordonnée.
Ce cas montre que le nationalisme économique contemporain ne se traduit pas nécessairement par un repli autarcique, mais plutôt par une reconfiguration des réseaux économiques selon des lignes géopolitiques. On assiste à l’émergence de ce que certains analystes appellent le « friend-shoring » ou « near-shoring », c’est-à-dire la réorganisation des chaînes d’approvisionnement pour privilégier les pays alliés ou géographiquement proches. Cette tendance s’observe également dans d’autres secteurs stratégiques comme les batteries électriques, les terres rares ou les technologies médicales.
Les facteurs structurels du retour au nationalisme économique
Si la confrontation sino-américaine constitue la manifestation la plus visible du nouveau nationalisme économique, ses causes profondes sont multiples et s’enracinent dans des transformations structurelles de l’économie mondiale. Quatre facteurs principaux peuvent être identifiés.
Premièrement, l’échec relatif des promesses de la mondialisation néolibérale a créé un terrain fertile pour les politiques économiques nationalistes. Dans de nombreux pays occidentaux, l’ouverture commerciale et financière des trois dernières décennies s’est accompagnée d’une désindustrialisation massive, d’une stagnation des salaires médians et d’un creusement des inégalités. Aux États-Unis, les travaux des économistes David Autor, David Dorn et Gordon Hanson ont documenté l' »effet Chine » sur l’emploi manufacturier américain : entre 1999 et 2011, l’augmentation des importations chinoises aurait causé la perte de 2,4 millions d’emplois industriels. Ces conséquences sociales ont progressivement érodé le consensus politique en faveur du libre-échange, créant un espace pour des discours économiques plus nationalistes, tant à droite qu’à gauche de l’échiquier politique.
Une nation sans usines est comme un arbre sans racines
Deuxièmement, la montée en puissance de la Chine a fondamentalement bouleversé l’équilibre géoéconomique mondial. Lorsque la Chine a intégré l’OMC en 2001, les décideurs occidentaux espéraient que l’ouverture économique favoriserait une libéralisation politique progressive. Cette « théorie de la convergence » s’est révélée largement erronée. Non seulement la Chine a maintenu son système politique autoritaire, mais elle a développé un modèle de « capitalisme d’État » qui combine intégration dans l’économie mondiale et contrôle politique centralisé. Ce modèle, perçu comme une alternative crédible au libéralisme occidental, constitue un défi idéologique majeur, d’autant plus qu’il a permis à la Chine de réaliser le développement économique le plus rapide de l’histoire moderne. Entre 2000 et 2020, la part de la Chine dans le PIB mondial est passée d’environ 3,6% à près de 18%, transformant radicalement les rapports de force économiques.
Troisièmement, les vulnérabilités révélées par les crises successives ont remis en question le dogme de l’efficience des marchés mondialisés. La crise financière de 2008 a montré les limites d’un système financier insuffisamment régulé. La pandémie de Covid-19 a ensuite mis en lumière la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondialisées et la dépendance excessive de nombreux pays occidentaux vis-à-vis de la production chinoise dans des secteurs critiques. Lorsque la France a découvert qu’elle ne disposait plus des capacités industrielles pour produire des masques chirurgicaux en quantité suffisante au début de la pandémie, la question de la souveraineté économique est revenue au centre du débat public. De même, les tensions sur les marchés énergétiques suite à l’invasion russe de l’Ukraine ont souligné l’importance stratégique de la sécurité énergétique et des chaînes d’approvisionnement résilientes.
La main invisible du marché devient visible quand elle saisit la gorge d’une nation.
Quatrièmement, les défis globaux comme le changement climatique et la révolution numérique imposent une redéfinition du rôle de l’État dans l’économie. La transition écologique nécessite des investissements massifs et une planification à long terme que les marchés seuls ne peuvent assurer. L’économiste Mariana Mazzucato a démontré le rôle crucial de l’État dans le financement des innovations technologiques majeures, remettant en question l’idée que l’innovation émerge spontanément du secteur privé. Ces défis systémiques légitiment un interventionnisme étatique accru et favorisent l’émergence de nouvelles formes de politiques industrielles, observables tant aux États-Unis avec l' »Inflation Reduction Act » qu’en Europe avec le « Green Deal » ou en Chine avec les plans quinquennaux centrés sur le développement durable.
L’économie mondialisée promet l’abondance mais oublie la résilience.
Ces facteurs structurels expliquent pourquoi le nationalisme économique transcende les clivages politiques traditionnels et s’observe dans des contextes politiques très différents. Il ne s’agit pas d’un simple retour au protectionnisme du XIXe siècle, mais d’une reconfiguration plus profonde des relations entre États et marchés, qui répond à des transformations systémiques de l’économie mondiale.
Applications contemporaines : Souverainisme versus nationalisme économique
Définir et distinguer deux concepts proches mais distincts
Au cœur de notre analyse se trouve la distinction cruciale entre souverainisme économique et nationalisme économique. Bien que souvent confondus dans le débat public, ces deux concepts renvoient à des logiques et des finalités différentes, dont les implications pour l’ordre économique international sont contrastées.
Le souverainisme économique peut être défini comme la volonté d’un État de préserver sa capacité à déterminer ses choix économiques fondamentaux et à protéger ses intérêts vitaux dans un contexte d’interdépendance mondiale. Il s’agit avant tout d’une posture défensive, orientée vers la résilience et l’autonomie stratégique. Le souverainisme économique ne rejette pas nécessairement la mondialisation, mais cherche à en maîtriser les effets et à maintenir un équilibre entre ouverture internationale et préservation des capacités nationales. Il se manifeste notamment par la protection des secteurs considérés comme stratégiques (énergie, alimentation, santé, technologies critiques), la régulation des investissements étrangers dans les entreprises sensibles, et le développement de politiques industrielles ciblées.
La puissance économique d’aujourd’hui fait la souveraineté de demain.
Le cas français offre une illustration intéressante de cette approche. Depuis la création du Commissariat général du Plan en 1946 jusqu’aux récents plans de relance post-Covid, la France a maintenu une tradition d’intervention étatique dans l’économie, indépendamment des alternances politiques. Le concept de « patriotisme économique », popularisé par l’ancien Premier ministre Dominique de Villepin en 2005 lors du blocage de l’acquisition de Danone par PepsiCo, s’inscrit dans cette tradition. Plus récemment, la loi PACTE de 2019 a renforcé le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques, tout en maintenant l’attractivité du territoire français pour les capitaux internationaux. Cette approche équilibrée illustre bien la logique du souverainisme économique : protéger les intérêts nationaux vitaux tout en restant intégré dans l’économie mondiale.
Le nationalisme économique, en revanche, adopte une posture plus offensive et conflictuelle. Il ne vise pas simplement à préserver l’autonomie nationale, mais à maximiser les avantages relatifs du pays par rapport à ses concurrents, dans une vision essentiellement mercantiliste des relations économiques internationales. Le nationalisme économique tend à considérer le commerce et les technologies comme des extensions de la compétition géopolitique, dans une logique de jeu à somme nulle. Il se traduit généralement par des politiques plus agressives : droits de douane élevés, subventions massives aux industries nationales, restrictions systématiques aux transferts de technologies, instrumentalisation des dépendances économiques à des fins géopolitiques.
Les politiques économiques de l’administration Trump, avec leur slogan « America First », illustrent cette logique nationaliste. L’imposition unilatérale de droits de douane, les menaces de retrait des accords commerciaux existants, l’utilisation de la puissance économique américaine pour obtenir des concessions politiques des partenaires commerciaux (comme dans le cas de l’ALENA renégocié), témoignent d’une vision fondamentalement compétitive des relations économiques internationales. De même, certains aspects de la politique économique chinoise actuelle, notamment l’utilisation de représailles économiques contre des pays adoptant des positions politiques jugées hostiles (comme l’Australie en 2020-2021), relèvent clairement du nationalisme économique.
Ce qui n’est pas produit chez soi devient une arme aux mains des autres.
Cette distinction conceptuelle n’est pas purement théorique ; elle a des implications concrètes pour l’avenir de l’ordre économique international. Un système international dominé par le souverainisme économique pourrait préserver les bénéfices essentiels de la coopération économique mondiale tout en redonnant aux États la marge de manœuvre nécessaire pour protéger leurs intérêts fondamentaux et maintenir la cohésion sociale. En revanche, la généralisation du nationalisme économique agressif risquerait d’entraîner une fragmentation excessive de l’économie mondiale, réduisant les gains de la spécialisation internationale et amplifiant les tensions géopolitiques.
La mise en œuvre concrète : politiques industrielles et contrôle des investissements
Pour illustrer cette distinction conceptuelle, examinons deux domaines d’action particulièrement significatifs : les politiques industrielles et le contrôle des investissements étrangers.
La réhabilitation des politiques industrielles constitue l’un des aspects les plus frappants du tournant économique actuel. Après plusieurs décennies où elles étaient considérées comme des anachronismes inefficaces, les politiques industrielles sont revenues au premier plan des stratégies économiques nationales, tant dans les pays développés que dans les économies émergentes. Ce renouveau s’explique par plusieurs facteurs : la nécessité de répondre aux défis du changement climatique, la volonté de sécuriser les chaînes d’approvisionnement stratégiques, et l’intensification de la compétition technologique.
L’Union européenne, longtemps considérée comme le bastion du libre-échange et de la concurrence non faussée, a opéré un virage significatif vers une politique industrielle plus active. La communication de la Commission européenne de mars 2020 sur « Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe », renforcée en mai 2021 après la pandémie, marque cette évolution. Les « projets importants d’intérêt européen commun » (PIIEC) permettent désormais de mobiliser des financements publics massifs dans des secteurs stratégiques comme les batteries électriques, l’hydrogène vert ou les semi-conducteurs, en dérogeant partiellement aux règles habituelles de la concurrence. Le plan de relance européen NextGenerationEU, avec ses 750 milliards d’euros, oriente explicitement les investissements vers la transition écologique et numérique. Cette approche, qui combine intervention publique et mécanismes de marché, s’inscrit clairement dans une logique de souverainisme économique.
Le libre-échange est comme le vent : bénéfique quand modéré, destructeur quand excessif.
Aux États-Unis, l’Inflation Reduction Act (IRA) adopté en août 2022 représente un tournant majeur dans la politique industrielle américaine. Avec près de 370 milliards de dollars d’investissements dans la transition énergétique, ce plan combine subventions directes, crédits d’impôt et exigences de contenu local. Sa particularité réside dans son caractère explicitement discriminatoire : certaines subventions sont conditionnées à la fabrication ou l’assemblage sur le sol américain, ou à l’utilisation de composants provenant des États-Unis ou de pays avec lesquels Washington a conclu des accords de libre-échange. Cette dimension nationaliste a suscité de vives réactions en Europe et en Asie, illustrant les tensions potentielles entre souverainisme légitime et nationalisme économique.
Le contrôle des investissements étrangers constitue un second domaine où la distinction entre souverainisme et nationalisme économique s’avère pertinente. Face à la montée des acquisitions chinoises dans les secteurs technologiques, de nombreux pays occidentaux ont renforcé leurs mécanismes de filtrage des investissements étrangers. En Europe, le règlement 2019/452 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers constitue une avancée significative dans cette direction. Sans imposer d’harmonisation forcée, ce dispositif encourage le partage d’informations entre États membres et définit un socle commun de secteurs sensibles (infrastructures critiques, technologies clés, sécurité alimentaire, accès aux informations sensibles).
L’approche européenne illustre une forme de souverainisme économique équilibré : elle vise à protéger les intérêts stratégiques légitimes sans fermer l’économie européenne aux capitaux étrangers. Le règlement ne prévoit pas de mécanisme automatique de blocage et laisse aux États membres la décision finale concernant les investissements sur leur territoire. Cette flexibilité reflète la volonté de maintenir un équilibre entre protection des intérêts vitaux et ouverture aux flux d’investissements internationaux.
Les démocraties s’épanouissent quand leurs économies ne dépendent pas des autocraties.
Aux États-Unis, l’approche est plus restrictive et s’inscrit davantage dans une logique de nationalisme économique. Le renforcement du Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) par le Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA) de 2018 a considérablement élargi le champ des investissements soumis à examen, avec un ciblage implicite mais évident des investissements chinois. Cette évolution s’est traduite par une augmentation significative des blocages ou des abandons d’acquisitions par des entreprises chinoises. Entre 2017 et 2022, le nombre d’opérations soumises au CFIUS a presque triplé, passant de 237 à 614, avec une attention particulière portée aux secteurs technologiques et aux données personnelles. Dans certains cas, cette approche a conduit à des décisions contestables, comme l’injonction faite à ByteDance de céder TikTok en 2020, qui semblait motivée autant par des considérations géopolitiques que par des préoccupations légitimes de sécurité nationale.
Le cas chinois offre un contraste intéressant. La Chine maintient depuis longtemps un système de contrôle des investissements étrangers parmi les plus restrictifs au monde, avec de nombreux secteurs fermés ou strictement encadrés. Cependant, sous la pression internationale et pour répondre à ses propres besoins de développement, Beijing a progressivement ouvert certains secteurs aux investisseurs étrangers. La « liste négative » des secteurs restreints ou interdits aux investisseurs étrangers a été réduite à plusieurs reprises, passant de 93 secteurs en 2017 à 31 en 2022. Cette évolution, bien que limitée et souvent accompagnée de barrières informelles, témoigne de la volonté chinoise de maintenir une forme d’intégration dans l’économie mondiale tout en préservant un contrôle étroit sur les secteurs stratégiques.
La relocalisation ramène plus que des usines : elle ramène l’espoir.
Ces exemples illustrent la diversité des approches nationales en matière de contrôle des investissements. Ils montrent également que la frontière entre souverainisme légitime et nationalisme économique reste floue et contestée. L’enjeu pour les années à venir sera de développer des cadres réglementaires qui permettent de protéger les intérêts nationaux légitimes sans tomber dans une logique de fermeture excessive qui réduirait les bénéfices de l’intégration économique mondiale.
L’impact de la montée des politiques nationalistes sur l’économie mondiale
Le retour du nationalisme économique n’est pas sans conséquences sur l’architecture de l’économie mondiale. Trois évolutions majeures peuvent être identifiées : la fragmentation des chaînes de valeur, la régionalisation des échanges et la transformation du système commercial multilatéral.
La fragmentation des chaînes de valeur mondiales constitue l’une des manifestations les plus visibles de cette reconfiguration. Depuis les années 1990, la production manufacturière s’était organisée selon une logique d’optimisation globale, fragmentant les processus productifs entre de multiples pays pour minimiser les coûts. Cette organisation, qui a permis des gains d’efficience considérables, est aujourd’hui remise en question par les préoccupations de sécurité économique. Les entreprises, encouragées par les politiques publiques, réorganisent progressivement leurs chaînes d’approvisionnement selon trois logiques complémentaires :
- Le « reshoring » ou relocalisation, qui consiste à rapatrier certaines productions stratégiques sur le territoire national. Cette tendance s’observe particulièrement dans les secteurs de la santé (médicaments essentiels, équipements médicaux), des composants électroniques critiques et des technologies liées à la transition énergétique. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), leader mondial des semi-conducteurs avancés, a ainsi annoncé la construction d’usines aux États-Unis et au Japon, répondant aux pressions politiques de ces pays pour sécuriser leurs approvisionnements.
- Le « nearshoring » ou régionalisation, qui vise à rapprocher géographiquement les sites de production des marchés de consommation finaux. Ce mouvement s’observe notamment en Amérique du Nord, où le Mexique bénéficie d’une relocalisation partielle des productions auparavant délocalisées en Asie. Entre 2020 et 2023, les investissements directs étrangers au Mexique ont augmenté de 40%, portés notamment par l’industrie automobile et électronique.
- Le « friendshoring », qui consiste à privilégier les pays alliés ou partageant les mêmes valeurs dans l’organisation des chaînes d’approvisionnement. Cette logique, explicitement promue par l’administration Biden, illustre la politisation croissante des relations économiques internationales. Les accords sur les minéraux critiques signés par les États-Unis avec le Japon, l’Union européenne ou l’Australie s’inscrivent dans cette perspective.
Cette fragmentation entraîne inévitablement des coûts économiques. Selon une étude du FMI publiée en 2023, une fragmentation géoéconomique complète pourrait réduire le PIB mondial de 7% à long terme, l’équivalent des PIB combinés de la France et de l’Allemagne. Cependant, ces coûts pourraient être partiellement compensés par une plus grande résilience face aux chocs externes et par la réduction des externalités négatives liées aux transports internationaux.
La deuxième tendance observable est la régionalisation croissante des échanges commerciaux et des flux d’investissements. Alors que la période 1990-2010 avait vu une expansion sans précédent du commerce transcontinental, les années récentes marquent un retour à des logiques régionales plus prononcées. Cette évolution s’observe dans les données commerciales : entre 2017 et 2022, le commerce intra-régional a augmenté plus rapidement que le commerce entre grandes régions économiques. En Asie de l’Est, la part du commerce intra-régional est passée de 45% à près de 60% sur cette période, reflétant l’intégration croissante des économies de la région autour de la Chine.
La valeur d’un produit national ne se mesure pas seulement à son prix, mais à sa contribution à l’indépendance.
Cette régionalisation s’accompagne d’une multiplication des accords commerciaux régionaux, qui remplacent progressivement les négociations multilatérales comme cadres privilégiés de la libéralisation commerciale. L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Partenariat économique régional global (RCEP) en Asie, ou l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) illustrent cette tendance. Ces accords régionaux intègrent désormais des domaines qui dépassent largement le cadre traditionnel du commerce de marchandises (services numériques, propriété intellectuelle, normes environnementales et sociales), témoignant d’une volonté d’harmonisation réglementaire à l’échelle régionale.
Enfin, la troisième évolution majeure concerne la transformation du système commercial multilatéral incarné par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Depuis l’échec du cycle de Doha en 2008, l’OMC traverse une crise profonde, aggravée par la paralysie de son mécanisme de règlement des différends entre 2019 et 2022. Cette crise reflète les tensions croissantes entre différentes visions du commerce international : l’approche libérale traditionnelle défendue par de nombreux pays occidentaux, l’approche développementaliste portée par les économies émergentes comme l’Inde, et l’approche dirigiste incarnée par la Chine.
Face à ces blocages, on observe une tendance à la « plurilatéralisation » des négociations commerciales : plutôt que de rechercher des accords universels, des groupes de pays partageant des intérêts communs développent des initiatives conjointes sur des sujets spécifiques. Cette approche, plus flexible mais aussi plus fragmentée, pourrait préfigurer un ordre commercial international moins centralisé et plus diversifié, où coexisteraient différents régimes réglementaires régionaux.
Synthèse et conclusion : Vers un nouvel équilibre entre mondialisation et souveraineté nationale ?
Les risques d’une fragmentation excessive de l’économie mondiale
Le regain du nationalisme économique comporte des risques significatifs qu’il serait imprudent d’ignorer. Le premier et le plus évident est celui d’une spirale protectionniste incontrôlée, comparable à celle des années 1930, où les mesures de rétorsion s’enchaîneraient jusqu’à provoquer un effondrement du commerce mondial. Si ce scénario extrême paraît peu probable dans le contexte actuel, en raison notamment de l’interdépendance beaucoup plus profonde des économies contemporaines, des dynamiques de fragmentation excessive restent possibles.
Le coût économique d’une telle fragmentation serait considérable. La spécialisation internationale et l’intégration des chaînes de valeur ont permis des gains d’efficience substantiels qui, malgré leurs effets distributifs inégaux, ont contribué à la croissance mondiale et à la réduction de la pauvreté extrême. Une remise en cause brutale de ces mécanismes entraînerait inévitablement des pertes de bien-être économique, particulièrement pour les économies en développement qui ont construit leurs stratégies de croissance sur l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales.
Le travail relocalisé nourrit plus que les corps : il nourrit l’âme d’une nation.
Au-delà des coûts directs, une fragmentation excessive de l’économie mondiale réduirait les capacités de coopération internationale face aux défis globaux comme le changement climatique ou les pandémies. Ces problèmes, par nature transnationaux, nécessitent des réponses coordonnées que seules des institutions multilatérales fonctionnelles peuvent organiser. Le repli nationaliste risquerait d’affaiblir ces mécanismes de gouvernance mondiale au moment même où ils sont le plus nécessaires.
La souveraineté économique est à la nation ce que l’autonomie est à l’individu.
Enfin, l’histoire montre que les tensions économiques se transforment souvent en conflits politiques, voire militaires. La compétition économique exacerbée entre les États-Unis et la Chine pourrait dégénérer en confrontation ouverte, particulièrement autour de la question taïwanaise, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Dans ce contexte, maintenir des canaux d’interdépendance économique, même redimensionnés, peut constituer un facteur de modération des tensions géopolitiques.
Les opportunités d’un rééquilibrage entre mondialisation et souveraineté démocratique
Si les risques sont réels, le retour du nationalisme économique peut également être interprété comme une opportunité de corriger les excès de l’hypermondialisation des dernières décennies et de reconstruire un système économique international plus équilibré et plus légitime.
L’une des principales critiques adressées à la mondialisation néolibérale concernait son déficit démocratique : les décisions économiques majeures échappaient de plus en plus au contrôle des citoyens, transférées vers des institutions internationales peu transparentes ou des marchés financiers volatils. Le « trilemme politique » identifié par Dani Rodrik semblait imposer un choix impossible entre intégration économique profonde, souveraineté nationale et démocratie. Le rééquilibrage actuel en faveur de la souveraineté nationale pourrait paradoxalement ouvrir un espace pour revitaliser les processus démocratiques, en redonnant aux communautés politiques la capacité de déterminer collectivement leurs priorités économiques.
Cette reconfiguration pourrait également favoriser l’émergence de modèles économiques plus diversifiés et mieux adaptés aux contextes locaux. L’uniformisation imposée par le « consensus de Washington » avait conduit à négliger l’importance des arrangements institutionnels spécifiques et des trajectoires de développement différenciées. Un ordre international plus respectueux des souverainetés nationales permettrait l’expérimentation de voies de développement alternatives, mieux ancrées dans les réalités sociales et culturelles de chaque pays.
Les nations qui oublient de protéger leurs industries stratégiques finissent par mendier leur protection.
Sur le plan environnemental, le nationalisme économique comporte des implications ambivalentes. D’un côté, la relocalisation de certaines productions pourrait réduire l’empreinte carbone liée aux transports internationaux et faciliter l’application de normes environnementales plus strictes. De l’autre, une fragmentation excessive risquerait de compliquer la coordination nécessaire face au changement climatique. L’enjeu sera de développer des mécanismes permettant de concilier souveraineté nationale et action collective globale, par exemple à travers des mécanismes d’ajustement carbone aux frontières comme celui en cours de déploiement dans l’Union européenne.
Enfin, le retour du nationalisme économique pourrait paradoxalement favoriser un renouveau démocratique, en remettant au centre du débat public des questions économiques fondamentales : quels secteurs doivent rester sous contrôle national ? Quels compromis entre efficience économique et résilience sommes-nous prêts à accepter ? Comment répartir équitablement les bénéfices et les coûts de l’intégration internationale ? Ces questions, longtemps considérées comme résolues par les élites économiques et politiques, reviennent aujourd’hui au cœur du débat démocratique, ouvrant la possibilité d’un nouveau contrat social plus inclusif.
Vers un nationalisme économique éclairé ?
Face à ces risques et opportunités, l’enjeu pour les années à venir sera de développer ce que l’on pourrait appeler un « nationalisme économique éclairé » ou un « souverainisme coopératif » – une approche qui préserverait les bénéfices essentiels de l’intégration économique internationale tout en redonnant aux États la marge de manœuvre nécessaire pour protéger leurs intérêts vitaux et maintenir la cohésion sociale.
Cette approche équilibrée reposerait sur plusieurs principes fondamentaux :
- La proportionnalité des mesures protectionnistes : les restrictions au commerce et aux investissements devraient être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour protéger des intérêts légitimes de sécurité nationale ou de bien-être collectif, et non utilisées comme instruments de politique commerciale agressive.
- La transparence et la prévisibilité : les politiques économiques nationales devraient être clairement communiquées et stables dans le temps, permettant aux entreprises et aux partenaires internationaux d’adapter leurs stratégies sans disruptions brutales.
- La réciprocité intelligente : plutôt qu’une réciprocité mécanique qui risquerait d’alimenter les spirales protectionnistes, les pays devraient rechercher des équilibres globaux dans leurs relations économiques, tenant compte des niveaux de développement et des spécificités nationales.
- La subsidiarité réglementaire : les normes et réglementations devraient être harmonisées au niveau international uniquement lorsque cela apporte une valeur ajoutée claire, laissant aux échelons nationaux et locaux la capacité d’adapter les règles aux contextes spécifiques.
- La solidarité internationale : les politiques nationalistes ne devraient pas se faire au détriment des pays les plus vulnérables, mais intégrer des mécanismes de compensation et de soutien aux économies en développement.
Ces principes pourraient fonder un nouveau compromis international, comparable à celui de l’après-guerre mais adapté aux réalités du XXIe siècle. Ce compromis reconnaîtrait explicitement le droit des communautés politiques à protéger leurs arrangements sociaux et leurs intérêts stratégiques, tout en maintenant un cadre commun de coopération économique internationale.
La mise en œuvre de cette vision équilibrée dépendra largement de l’évolution des relations sino-américaines. Si les deux superpuissances parviennent à développer ce que le président Biden a appelé une « compétition responsable », évitant l’escalade vers un conflit ouvert, un nouvel équilibre international pourrait émerger progressivement. Cet équilibre serait probablement plus fragmenté que l’ordre libéral d’après-guerre, avec des sphères d’influence économique plus marquées, mais pourrait préserver les éléments essentiels de la coopération internationale.
Le protectionnisme intelligent protège moins les industries que les savoir-faire.
L’Union européenne, par sa nature même d’espace politique transnational reposant sur un équilibre entre intégration économique et diversité nationale, pourrait jouer un rôle crucial dans la définition de ce nouveau modèle. Sa capacité à combiner ouverture commerciale, politiques industrielles ambitieuses et protection des standards sociaux et environnementaux pourrait inspirer une voie médiane entre les approches américaine et chinoise.
En définitive, le défi des décennies à venir ne sera pas de choisir entre mondialisation et souveraineté nationale, mais de réinventer leur articulation pour répondre aux défis du XXIe siècle. Un nationalisme économique éclairé, respectueux des interdépendances mondiales mais soucieux de préserver les espaces démocratiques nationaux, pourrait constituer une réponse adaptée à ce défi historique. L’alternative – une fragmentation conflictuelle de l’économie mondiale – comporterait des risques considérables pour la prospérité et la paix mondiales.
FAQs : Comprendre le nationalisme économique contemporain
1. Quelle est la différence fondamentale entre le souverainisme économique et le nationalisme économique ?
Le souverainisme économique vise principalement à préserver la capacité d’un État à déterminer ses choix économiques fondamentaux et à protéger ses intérêts vitaux, dans une logique essentiellement défensive. Il ne rejette pas l’intégration internationale mais cherche à en maîtriser les effets. Le nationalisme économique, quant à lui, adopte une posture plus offensive, cherchant à maximiser les avantages relatifs du pays par rapport à ses concurrents, souvent dans une vision mercantiliste des relations internationales. Si le souverainisme est compatible avec un ordre international coopératif, le nationalisme économique tend vers une vision plus conflictuelle des relations économiques entre nations.
2. La montée du nationalisme économique signifie-t-elle la fin de la mondialisation ?
Non, mais elle annonce sa profonde transformation. Plutôt qu’une « démondialisation » complète, nous assistons à une reconfiguration des flux économiques internationaux selon des logiques plus politiques. Les chaînes de valeur se réorganisent pour privilégier la résilience et la sécurité, les échanges se régionalisent autour de pôles géopolitiques, et certains secteurs stratégiques font l’objet d’une attention renouvelée des États. La mondialisation persiste, mais sous une forme plus fragmentée, plus politisée et probablement moins intensive en termes de flux transfrontaliers de marchandises.
3. Les politiques industrielles nationales sont-elles compatibles avec un système commercial international ouvert ?
Elles peuvent l’être, sous certaines conditions. Les politiques industrielles modernes diffèrent des approches protectionnistes traditionnelles : elles visent moins à isoler les marchés nationaux qu’à développer des capacités compétitives dans des secteurs d’avenir ou stratégiques. Si elles respectent certains principes (transparence, non-discrimination, proportionnalité), elles peuvent coexister avec un système commercial relativement ouvert. L’enjeu est de développer des règles internationales qui encadrent ces politiques sans les interdire, reconnaissant leur légitimité tout en prévenant leurs potentiels effets distorsifs.
4. Le nationalisme économique favorise-t-il ou menace-t-il la démocratie ?
La relation entre nationalisme économique et démocratie est complexe et ambivalente. D’un côté, en redonnant aux États une marge de manœuvre face aux marchés globalisés, le nationalisme économique peut renforcer la capacité des processus démocratiques à influencer les choix économiques. De l’autre, certaines formes de nationalisme économique peuvent alimenter des tendances illibérales, en légitimant des concentrations de pouvoir excessives au nom de l’intérêt national ou en stimulant des sentiments xénophobes. L’impact sur la démocratie dépend donc largement de la forme spécifique que prend le nationalisme économique et du contexte institutionnel dans lequel il s’inscrit.
5. Comment concilier souveraineté économique nationale et action collective face aux défis globaux comme le changement climatique ?
Ce défi est au cœur des débats contemporains sur la gouvernance mondiale. Plusieurs pistes émergent pour résoudre cette tension apparente : le développement de mécanismes d’ajustement aux frontières (comme la taxe carbone européenne) qui permettent de concilier politiques nationales ambitieuses et prévention du dumping environnemental ; la création de « clubs climatiques » regroupant des pays partageant des ambitions similaires ; ou encore l’établissement de standards minimaux internationaux laissant aux États la flexibilité de définir leurs propres trajectoires de transition. Plus fondamentalement, il s’agit de réinventer le multilatéralisme pour le rendre plus flexible et plus respectueux des diversités nationales, tout en maintenant sa capacité à coordonner l’action collective face aux défis communs.