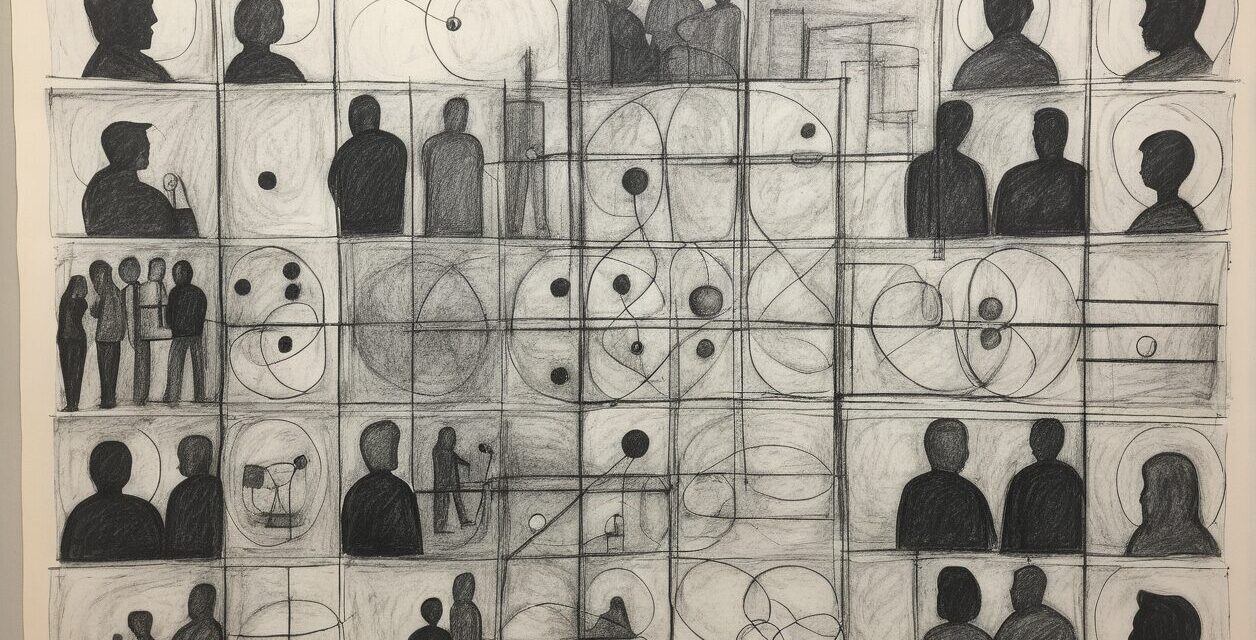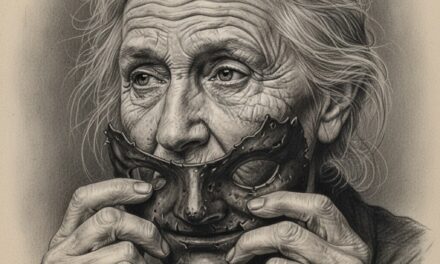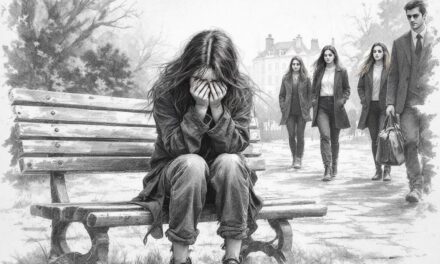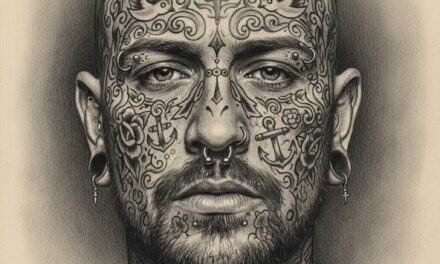Vous souvenez-vous de votre premier jour d’école ? Cette image mentale que vous chérissez – votre cartable, l’odeur de la classe, votre enseignante – est-elle vraiment votre souvenir ? Ou bien s’agit-il d’une reconstruction façonnée par les récits familiaux, les photos commentées lors des repas de famille, et les attentes sociales sur ce que devrait être ce moment fondateur ?
Cette question trouble notre intuition la plus intime. Maurice Halbwachs, sociologue français élève de Durkheim, bouleverse en 1925 notre conception du souvenir avec son ouvrage majeur Les Cadres sociaux de la mémoire. Sa thèse révolutionnaire tient en une formule dérangeante : il n’existe pas de mémoire purement individuelle. Nos souvenirs les plus personnels sont en réalité des constructions collectives, élaborées dans et par nos groupes sociaux d’appartenance.
Table des matières
Halbwachs et la révolution du souvenir
Maurice Halbwachs (1877-1945) développe dans ses travaux une théorie radicale qui rompt avec la psychologie classique de son époque. Alors que celle-ci considère la mémoire comme une faculté purement individuelle, Halbwachs démontre que se souvenir est toujours un acte social.
Pour comprendre cette révolution intellectuelle, il faut d’abord saisir le contexte théorique. Halbwachs s’inscrit dans la tradition durkheimienne et prolonge l’idée de conscience collective de Durkheim en l’appliquant au domaine du souvenir. Si Durkheim montrait que nos façons de penser sont sociales, Halbwachs va plus loin : nos façons de nous souvenir le sont également.
💡 DÉFINITION : Mémoire collective
La mémoire collective désigne l’ensemble des souvenirs et représentations du passé qu’un groupe social partage et transmet. Elle ne se réduit pas à la somme des mémoires individuelles mais constitue un cadre de pensée commun qui permet aux individus de reconstruire leurs propres souvenirs.
Exemple : Le souvenir du 11 septembre 2001 n’est pas seulement une juxtaposition de millions de mémoires individuelles, mais un récit collectif construit par les médias, les commémorations et les discussions sociales.
La thèse centrale d’Halbwachs repose sur le concept de cadres sociaux de la mémoire. Ces cadres désignent les structures sociales, les langages, les repères temporels et spatiaux fournis par nos groupes d’appartenance – famille, classe sociale, nation, génération – qui nous permettent de localiser, organiser et interpréter nos souvenirs.
Sans ces cadres collectifs, affirme Halbwachs, nos souvenirs individuels n’existeraient tout simplement pas. Un enfant élevé hors de tout contact social – cas hypothétique mais théoriquement envisageable – ne pourrait constituer de mémoire autobiographique cohérente. C’est le groupe qui nous fournit les points de repère nécessaires pour transformer une sensation brute en souvenir structuré et durable.
L’originalité d’Halbwachs tient aussi à sa méthode. Dans La Topographie légendaire des évangiles en Terre sainte(1941), il analyse comment les lieux saints chrétiens ont été « construits » socialement au fil des siècles, montrant que même la mémoire religieuse la plus sacrée obéit à des logiques sociales d’appropriation du passé.
Les cadres sociaux de la mémoire en action
Comment cette théorie abstraite s’observe-t-elle concrètement ? Les exemples contemporains abondent et révèlent la puissance explicative du concept de mémoire collective.
Prenons d’abord l’échelle familiale. Lors d’un repas de famille, plusieurs générations évoquent « le mariage de tante Marie en 1995 ». Chaque participant possède son propre souvenir, mais ces souvenirs individuels se recomposent et se valident mutuellement par l’échange. L’oncle Pierre raconte l’incident du gâteau renversé, la cousine Sophie complète avec le discours émouvant du grand-père. Progressivement, un récit familial cohérent émerge, qui devient le souvenir partagé de l’événement.
Cette dynamique illustre ce qu’Halbwachs appelle la reconstruction du souvenir. Nous ne « stockons » pas nos souvenirs comme des fichiers sur un disque dur. Nous les reconstruisons à chaque fois que nous nous souvenons, en mobilisant les cadres sociaux disponibles. La socialisation primaire et secondaire joue ici un rôle fondamental : elle nous transmet les schèmes de pensée qui permettront ensuite d’organiser nos expériences passées.
Sur les réseaux sociaux, la théorie d’Halbwachs trouve une application saisissante. Facebook propose depuis 2012 la fonctionnalité « Souvenirs » (Memories) qui rappelle aux utilisateurs ce qu’ils ont publié les années précédentes. Cette fonctionnalité ne se contente pas de restituer le passé : elle le reconstruit selon une logique algorithmique qui sélectionne les « meilleurs moments » (photos likées, événements heureux).
📊 CHIFFRE-CLÉ
83% des utilisateurs de Facebook consultent régulièrement leurs « Souvenirs » et 67% déclarent que cette fonctionnalité modifie leur perception de leur propre passé (données Cambridge 2023).
Source : Cambridge Digital Memory Study, 2023
Cette statistique révèle un phénomène halbwachsien typique : la plateforme devient un nouveau cadre social de la mémoire, qui formate nos souvenirs individuels selon ses propres critères. Les moments tristes ou banals disparaissent de ce « journal intime algorithmique », créant une mémoire collective aseptisée et positive.
À l’échelle nationale, les commémorations illustrent magistralement la mémoire collective en action. Le 11 novembre en France ne commémore pas seulement l’armistice de 1918 : il perpétue un récit national sur le sacrifice, l’unité républicaine et la mémoire des « Poilus ». Les cérémonies, les discours, les monuments aux morts constituent autant de cadres sociaux qui structurent la mémoire collective française de la Première Guerre mondiale.
Chaque 13 novembre depuis 2015, la France commémore les attentats du Bataclan. Ce qui était initialement vécu comme des expériences individuelles traumatisantes (pour les victimes directes et leurs proches) devient progressivement une mémoire collective nationale, partagée par l’ensemble de la société française via les cérémonies officielles, les médias et les discussions publiques.
Le rôle des générations dans la transmission mémorielle
Halbwachs accorde une attention particulière aux générations comme cadres sociaux spécifiques. Une génération partage des expériences historiques communes qui façonnent durablement sa vision du monde et sa mémoire.
La génération qui a connu Mai 68 conserve une mémoire collective de cet événement qui diffère radicalement de celle des générations suivantes. Pour les premiers, il s’agit d’une expérience vécue, ancrée dans des souvenirs sensoriels et émotionnels. Pour les seconds, Mai 68 n’existe que comme récit transmis, médiatisé par les livres d’histoire, les documentaires et les témoignages.
Cette distinction éclaire les débats mémoriels actuels. Lorsque la mémoire de la Shoah passe des témoins directs (de moins en moins nombreux) aux générations suivantes, elle change de nature : elle devient pleinement une mémoire collective, détachée de l’expérience vécue et maintenue par des institutions, des rituels et des récits partagés.
Quand la mémoire collective devient un enjeu politique
La dimension politique de la mémoire collective fascine particulièrement les sociologues contemporains. Si nos souvenirs sont socialement construits, alors ceux qui contrôlent les cadres sociaux contrôlent aussi, dans une certaine mesure, notre rapport au passé.
Les régimes autoritaires l’ont bien compris. La réécriture de l’histoire, la destruction d’archives, l’imposition d’un récit officiel visent à façonner la mémoire collective selon les intérêts du pouvoir. Orwell, dans 1984, a magistralement anticipé cette problématique avec son Ministère de la Vérité qui réécrit constamment le passé.
Mais les démocraties ne sont pas exemptes de ces enjeux. En France, les « guerres de mémoire » autour de la colonisation, de Vichy ou de l’esclavage révèlent des luttes pour imposer certains cadres d’interprétation du passé. Chaque groupe social tente de faire reconnaître sa propre mémoire collective comme légitime.
L’historien Pierre Nora a prolongé la réflexion d’Halbwachs avec son concept de « lieux de mémoire » dans les années 1980. Ces lieux – qui peuvent être physiques (le Panthéon), symboliques (La Marseillaise) ou temporels (le 14 juillet) – incarnent et perpétuent la mémoire collective nationale. Ils constituent les points d’ancrage matériels des cadres sociaux halbwachsiens.
Cette institutionnalisation de la mémoire soulève des questions éthiques et politiques. Qui décide quels événements méritent d’être commémorés ? Quelles versions du passé doivent être enseignées à l’école ? Ces débats illustrent ce que certains sociologues appellent la « violence symbolique » mémorielle : l’imposition d’un récit dominant qui marginalise d’autres mémoires collectives.
Le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis a ainsi déclenché un débat sur les monuments confédérés. Faut-il détruire ces « lieux de mémoire » qui perpétuent une certaine vision (héroïque) du passé esclavagiste ? Ou faut-il les conserver comme témoins historiques ? Cette controverse est fondamentalement halbwachsienne : elle porte sur les cadres matériels qui structurent la mémoire collective américaine.
Conclusion
Maurice Halbwachs nous offre une grille de lecture puissante pour comprendre comment nos sociétés se rapportent à leur passé. En démontrant que la mémoire est toujours sociale, il révèle un paradoxe troublant : nos souvenirs les plus intimes ne nous appartiennent jamais vraiment. Ils sont le produit de nos appartenances collectives, façonnés par les groupes sociaux qui nous ont constitués.
Cette théorie résonne avec une acuité particulière à l’ère numérique. Les réseaux sociaux, les algorithmes de recommandation et les plateformes de partage deviennent de nouveaux cadres sociaux qui formatent notre rapport au passé. La mémoire collective n’est plus seulement nationale ou familiale : elle devient aussi algorithmique.
Et vous, quels sont les « cadres sociaux » qui structurent vos propres souvenirs ? Famille, école, médias, réseaux sociaux… chacun contribue à façonner la mémoire que vous avez de votre vie. Prendre conscience de ces mécanismes, c’est peut-être gagner un peu de liberté face à nos propres souvenirs.
📚 POUR ALLER PLUS LOIN :
→ CRÉER : La conscience collective selon Durkheim : fondements théoriques → CRÉER : Socialisation et identité : comment devenons-nous qui nous sommes ? → CRÉER : Lieux de mémoire selon Pierre Nora : quand l’espace incarne le temps
💬 Cet article vous a éclairé ? Partagez-le pour rendre la sociologie accessible à tous !
FAQ
Qu’est-ce que la mémoire collective selon Halbwachs ?
La mémoire collective désigne l’ensemble des souvenirs partagés par un groupe social qui structure la façon dont ses membres se remémorent leur passé. Selon Maurice Halbwachs, nos souvenirs individuels sont toujours construits à partir de cadres sociaux (famille, classe, nation) qui nous fournissent les repères nécessaires pour organiser et interpréter nos expériences passées. Il n’existe donc pas de mémoire purement individuelle.
Quelle est la différence entre mémoire collective et mémoire individuelle ?
Pour Halbwachs, cette distinction n’est pas absolue. La mémoire individuelle n’existe qu’en s’appuyant sur des cadres collectifs fournis par nos groupes d’appartenance. Ce que nous considérons comme un souvenir personnel est en réalité reconstruit à partir de langages, de repères temporels et d’interprétations partagées socialement. La mémoire collective n’est pas la somme des mémoires individuelles mais le cadre qui les rend possibles.
Pourquoi la mémoire collective est-elle importante en sociologie ?
La mémoire collective est fondamentale car elle assure la continuité et l’identité des groupes sociaux. Elle explique comment une société transmet ses valeurs, ses normes et son histoire aux nouvelles générations. Comprendre les mécanismes de la mémoire collective permet d’analyser les luttes politiques autour du passé, les commémorations nationales et les débats sur l’enseignement de l’histoire. C’est aussi un outil pour déconstruire les récits dominants et révéler les mémoires marginalisées.
Comment les réseaux sociaux transforment-ils la mémoire collective ?
Les réseaux sociaux créent de nouveaux cadres sociaux de la mémoire en sélectionnant, organisant et valorisant certains souvenirs plutôt que d’autres. Les algorithmes de Facebook, Instagram ou TikTok déterminent quels moments passés nous sont rappelés et comment ils sont présentés. Cela produit une mémoire collective algorithmique, souvent aseptisée et positive, qui peut entrer en tension avec d’autres formes de mémoire (familiale, nationale, historique). Les hashtags commémoratifs (#JeSuisCharlie, #MeToo) deviennent aussi des lieux de mémoire numérique.
Comment la mémoire collective est-elle transmise d’une génération à l’autre ?
La transmission mémorielle s’opère à travers plusieurs canaux : les récits familiaux, l’éducation scolaire, les commémorations publiques, les médias et les lieux de mémoire (monuments, musées). Cependant, Halbwachs souligne que cette transmission n’est jamais passive. Chaque génération reconstruit la mémoire collective héritée en fonction de ses propres préoccupations et contextes sociaux. C’est pourquoi la mémoire de Mai 68 ou de la Seconde Guerre mondiale évolue avec le temps.
Bibliographie
- Halbwachs, Maurice. 1925. Les Cadres sociaux de la mémoire. Paris : Albin Michel (réédition 1994).
- Halbwachs, Maurice. 1950. La Mémoire collective. Paris : PUF (édition posthume, réédition 1997).
- Nora, Pierre (dir.). 1984-1992. Les Lieux de mémoire (3 volumes). Paris : Gallimard.
- Ricœur, Paul. 2000. La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli. Paris : Seuil.
Article rédigé par Élisabeth de Marval | 2 novembre 2025 | Fondamentaux | Temps de lecture : 7 min