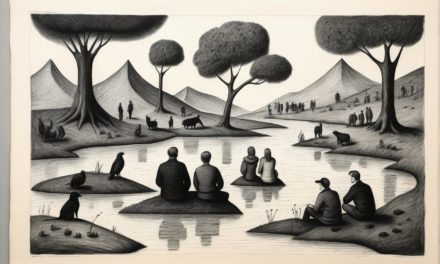Un enfant malien, six ans peut-être. Ses côtes dessinent des ombres sous une peau tendue. Derrière lui, un camion rutilant aux couleurs d’une multinationale. Cette photographie résume notre époque : toutes les sept secondes, un enfant meurt de faim sur cette planète qui produit assez pour nourrir 12 milliards d’humains.
Nous sommes 8 milliards. 295 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire aiguë en 2025. À Gaza, neuf enfants sur dix survivent avec deux groupes alimentaires par jour. Au Soudan, 755 000 personnes font face à la famine — ce chiffre était de zéro en 2023.
Ces nombres ne sont pas des accidents. Comme l’écrit le sociologue Jean Ziegler, nous vivons sous un « ordre cannibale du monde » où la faim n’est plus une fatalité, mais un outil de domination. Voici l’histoire de cette machinerie invisible qui transforme la misère en profit.
Comment la dette et les réformes tuent
Dans les couloirs du Fonds monétaire international, on ne parle jamais d’enfants qui meurent. On évoque des « ajustements structurels », des « réformes nécessaires ». Ce langage technocratique cache une réalité brutale : l’organisation méthodique de la pauvreté.
L’exemple de la Mauritanie révèle la perversité du système. Avant les réformes imposées par le FMI, 5% du riz consommé était produit localement. Après la « modernisation », cette proportion atteint 50%. Victoire ? Non. Le riz mauritanien coûte désormais deux fois plus cher que celui importé de Thaïlande.
Résultat : une augmentation rapide de la malnutrition chez les populations les plus pauvres. Julius Nyerere, ancien président de Tanzanie, posait déjà la question : « Devons-nous continuer à laisser mourir de faim nos enfants dans le seul but de rembourser nos dettes ? »
💡 DÉFINITION : Ajustement structurel
Ensemble de réformes économiques imposées par le FMI et la Banque mondiale aux pays endettés : privatisations, libéralisation des marchés, réduction des dépenses publiques. Ces mesures enrichissent souvent les élites locales et les multinationales, tout en appauvrissant les populations.
Exemple : En Angola, 4 milliards de dollars de recettes pétrolières détournés sur des comptes offshore entre 1998 et 2002, pendant que l’espérance de vie plongeait sous 40 ans.
La dette africaine tue plus sûrement que les armes. 163 millions d’Africains font face à une insécurité alimentaire aiguë, et 80% vivent dans des pays en conflit. Cette corrélation n’est pas fortuite : elle révèle un système que Bourdieu aurait qualifié de violence symbolique devenue concrète.
Michel Foucault analysait le biopouvoir comme la gestion de la vie et de la mort. Les multinationales ont perfectionné cette technique : elles ne tuent plus directement, elles organisent les conditions de la mort à travers des contrats, des programmes économiques, des réformes.
Pétrole, or et coltan : la géographie de la mort
« L’avenir du continent dépend de la façon dont il gère ses ressources », explique Abiodun Alao, chercheur à l’université de Londres. Sauf que l’Afrique ne gère plus ses ressources. Ce sont les multinationales qui s’en chargent.
La République Démocratique du Congo incarne ce paradoxe tragique. Ce pays pourrait nourrir 200 millions d’habitants avec ses terres fertiles. Pourtant, ses enfants meurent de faim pendant que sept pays s’affrontent pour le contrôle de ses minerais. Le coltan, indispensable à nos téléphones, a « la couleur du bitume, l’odeur de l’argent et le goût du sang ».
Nicolas Berman et son équipe de l’École d’économie de Paris ont démontré scientifiquement ce que les ONG dénoncent : la présence de firmes étrangères en Afrique augmente la violence dans les territoires miniers. Leur étude géolocalisée révèle qu’une hausse des prix des matières premières augmente la violence uniquement dans les zones exploitées par des multinationales.
Pourquoi ? Parce que les entreprises locales bénéficient de la protection de l’État, tandis que les multinationales négocient directement avec les groupes armés. Elles alimentent une économie de guerre qui transforme chaque gisement en cimetière.
📊 CHIFFRE-CLÉ
56 millions d’hectares de terres africaines ont fait l’objet de contrats internationaux depuis la crise de 2008, selon la Banque mondiale. Ces terres arrachées aux populations locales servent à produire des agrocarburants pour automobiles occidentales pendant que les enfants qui y vivaient meurent de faim.
Au Mali, plus de 300 000 enfants de moins de cinq ans souffrent d’émaciation sévère en 2024. Pendant ce temps, les mines d’or de Kidal enrichissent les seigneurs de guerre. Au Tchad, 500 000 enfants sont menacés de malnutrition sévère tandis que les revenus pétroliers s’évaporent dans les paradis fiscaux.
Cette géographie de la mort suit exactement la carte des ressources naturelles. L’eau elle-même devient arme de guerre : l’Égypte a créé une « armée du Nil » pour contrôler tout projet hydraulique. Les famines du Sahel ne sont plus causées par la sécheresse, mais par cette militarisation de la soif.
Cette dynamique rejoint l’analyse de la mondialisation comme système d’extraction de richesses du Sud vers le Nord, avec de nouvelles méthodes mais des objectifs inchangés depuis l’époque coloniale.
L’accaparement des terres : spéculer sur la faim
Naomi Klein l’avait anticipé dans La Stratégie du choc : les crises ne sont plus des opportunités à saisir, mais des produits à fabriquer. Depuis 2008, la terre est devenue un placement financier comme l’or.
En Somalie et en Éthiopie, cette spéculation a directement contribué à la famine de 2011 qui a tué 260 000 personnes. Le Soudan a subi une déforestation massive pour faire place à des plantations d’agrocarburants. Résultat : 25,6 millions de personnes — la moitié de la population — font face à l’insécurité alimentaire.
L’ironie est glaçante : ce pays, historiquement le plus grand producteur agricole d’Afrique, importe désormais sa nourriture. Cette transformation n’est pas accidentelle. Elle répond à une logique implacable : extraire la richesse pour nourrir l’opulence du Nord.
Pourquoi l’Occident ferme les yeux
« Dans un monde d’abondance, rien ne justifie que des enfants souffrent de la faim ou meurent de malnutrition », déclare Catherine Russell, directrice de l’UNICEF. Cette évidence morale se heurte à une réalité politique complexe : les démocraties occidentales sont complices actives de ce système.
Sophie Coignard, dans L’Oligarchie des incapables, décortique ces mécanismes. Elle montre comment l’entremêlement des pouvoirs politique et économique crée des zones d’impunité où prospèrent les trafics d’influence. La corruption n’est plus l’exception, elle est devenue la règle.
Les mêmes cabinets d’avocats qui défendent les multinationales dans les paradis fiscaux rédigent les contrats d’exploitation minière en Afrique. Les mêmes banques qui blanchissent l’argent du pétrole angolais financent les campagnes électorales en Europe et en Amérique.
Le secret professionnel devient omerta. Ces avocats « du troisième type » mettent des gens en relation, pèsent sur les décisions publiques, font du trafic d’influence — sans rédiger aucun document. Ils empochent des millions pour du « conseil au pénal » fantôme.
Pendant ce temps, les médias des démocraties entretiennent l’illusion de la fatalité. La famine ? La sécheresse. Les conflits ? L’ethnicité. La corruption ? Quelques brebis galeuses. Cette narration occulte la dimension systémique du problème.
Car les famines modernes sont politiques. « Quiconque meurt de faim est victime d’un assassinat », proclame Jean Ziegler. Un assassinat commis par des firmes cotées en bourse, cautionné par des gouvernements démocratiquement élus, financé par des épargnants qui ignorent où va leur argent.
L’Union européenne finance des programmes de « développement » en Afrique tout en négociant des accords commerciaux qui ruinent l’agriculture locale. Elle verse des millions à l’aide humanitaire tout en autorisant ses multinationales à piller les ressources africaines. Cette schizophrénie institutionnelle n’est pas un bug, c’est une caractéristique du système.
La spéculation qui affame
Les hedge funds spéculent sur les prix alimentaires, créant des bulles qui affament les plus pauvres. Goldman Sachs a inventé les « commodity index funds » qui ont multiplié par cinq les investissements spéculatifs sur les matières premières agricoles entre 2003 et 2008.
Résultat : les émeutes de la faim de 2008 qui ont embrasé 33 pays. Les ultra-riches accumulent pendant que les pauvres meurent. Plus de 2 milliards d’êtres humains vivent dans la « misère absolue », selon le PNUD.
Sur ces milliards de personnes, les multinationales exercent un droit de vie et de mort. Par leurs stratégies d’investissement, leurs spéculations monétaires, leurs alliances politiques, elles décident chaque jour de qui a le droit de vivre et de qui est condamné à mourir.
De l’indignation à l’action collective
L’enfant de la photographie est mort. Il s’appelait peut-être Amadou, Fatima ou Kofi. Il était l’un des 36 millions d’enfants de moins de cinq ans qui souffrent de malnutrition aiguë dans 32 pays. Sa mort n’était pas inéluctable. Elle était programmée.
Pourtant, face à cette machinerie de mort, des résistances s’organisent. Jean Ziegler place son espoir dans la « nouvelle société civile planétaire » : les 500 000 paysans thaïlandais du Forum des pauvres, les 17 millions de signatures pour l’abolition de la dette du tiers-monde, la coalition « Publish What You Pay » qui force les multinationales à dévoiler leurs contrats.
Ces initiatives montrent que la transparence peut être une arme. Mais elles restent limitées tant qu’elles ne s’attaquent pas aux structures du système. Car il ne suffit pas de rendre la corruption transparente ; il faut la rendre impossible.
Cela suppose une révolution de la gouvernance mondiale : fermer les paradis fiscaux, soumettre les multinationales à une justice internationale, transformer les institutions financières en outils de développement plutôt que de spéculation.
Cela suppose surtout une révolution des consciences dans les démocraties du Nord. Car tant que les électeurs ignorent le prix de leur prospérité, tant qu’ils ferment les yeux sur l’origine de leurs profits, le système perdurera.
Conclusion
Nous produisons assez pour nourrir 12 milliards d’êtres humains. Nous ne sommes que 8 milliards. Et pourtant, 733 millions de personnes souffrent de la faim. Cette équation simple révèle la faillite morale de notre civilisation.
La famine n’est plus une fatalité. Elle est un choix. Le choix de quelques-uns qui condamne des millions d’autres. Le temps de l’indignation est passé. Vient celui de l’action politique qui transforme les structures, pas seulement les symptômes.
Combien de temps encore accepterons-nous d’être cannibales ?
📚 POUR ALLER PLUS LOIN :
→ La face cachée de la mondialisation : quand les élites organisent le pillage
→ Les ultra-riches et le vol des pauvres : anatomie d’un système
→ L’habitus de Bourdieu : comprendre les mécanismes de domination sociale
💬 Partagez cet article si vous pensez que la sociologie peut changer le monde.
FAQ
Pourquoi parle-t-on de famine alors que le monde produit assez de nourriture ?
Parce que la famine moderne n’est pas causée par un manque de production, mais par des choix politiques et économiques. La dette, les ajustements structurels imposés par le FMI, l’accaparement des terres par les multinationales et la spéculation sur les denrées alimentaires créent artificiellement la pénurie. Comme l’affirme Jean Ziegler, « quiconque meurt de faim est victime d’un assassinat », pas d’une fatalité naturelle.
Quel est le lien entre les ressources naturelles et la famine en Afrique ?
Les pays africains riches en pétrole, or ou minerais connaissent paradoxalement les pires taux de malnutrition. Les multinationales exploitent ces ressources en négociant directement avec des groupes armés, alimentant des conflits permanents. La RDC, qui pourrait nourrir 200 millions de personnes, voit ses enfants mourir de faim pendant que sept pays se battent pour son coltan. Les revenus de ces ressources sont détournés vers des paradis fiscaux plutôt que d’alimenter les populations locales.
Comment la dette des pays pauvres contribue-t-elle à la famine ?
Le FMI et la Banque mondiale imposent des « ajustements structurels » aux pays endettés : privatisations, libéralisation des marchés, réduction des dépenses publiques. En Mauritanie, ces réformes ont doublé le prix du riz local, rendant la nourriture inaccessible aux plus pauvres. 163 millions d’Africains souffrent d’insécurité alimentaire, et 80% vivent dans des pays en conflit lié à la dette. Le remboursement de la dette passe avant la survie des populations.
Que signifie l’accaparement des terres ?
Depuis la crise de 2008, 56 millions d’hectares de terres africaines ont été achetés ou loués par des investisseurs étrangers pour produire des agrocarburants ou spéculer. Ces terres, arrachées aux populations locales pour des montants dérisoires, ne nourrissent plus les communautés mais les marchés internationaux. Le Soudan, historiquement grenier de l’Afrique, importe désormais sa nourriture après avoir converti ses terres en plantations pour l’exportation.
Que peut faire la société civile face à ce système ?
La société civile mondiale s’organise : 17 millions de signatures pour l’annulation de la dette, coalitions comme « Publish What You Pay » qui forcent les multinationales à dévoiler leurs contrats, mouvements paysans regroupant des centaines de milliers de personnes. L’action passe par la transparence (fermer les paradis fiscaux), la justice internationale pour les multinationales, et surtout la prise de conscience dans les démocraties du Nord que leur prospérité repose sur ce système d’exploitation.
Bibliographie
- Ziegler, Jean. 2002. Les Nouveaux Maîtres du Monde et ceux qui leur résistent. Paris : Fayard.
- Coignard, Sophie. 2012. L’Oligarchie des incapables. Paris : Albin Michel.
- Klein, Naomi. 2008. La Stratégie du choc. Arles : Actes Sud.
- UNICEF. 2024. « Un enfant sur quatre dans le monde est en situation de pauvreté alimentaire sévère ». Rapport mondial.
- Berman, Nicolas et al. 2024. « Le rôle des multinationales dans les violences en Afrique ». The Conversation, juin.