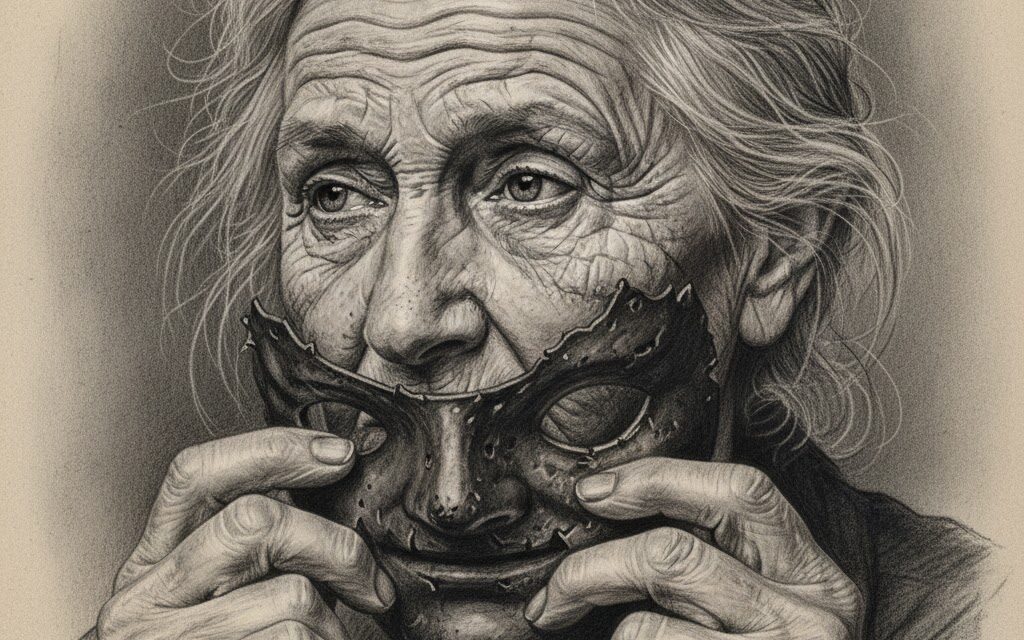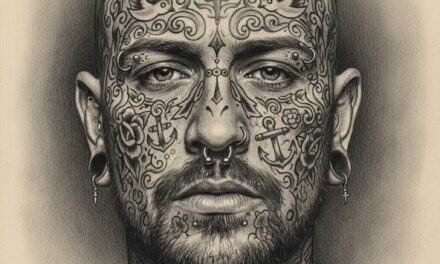Vous prenez dix photos avant de poster la « bonne » sur Instagram. Vous cachez votre chambre en désordre avant un appel Zoom. Vous souriez poliment à votre belle-mère alors que vous pensez tout autre chose. Félicitations : vous appliquez sans le savoir la théorie de la présentation de soi d’Erving Goffman.
Ce sociologue canadien des années 1960 a révolutionné notre compréhension des interactions sociales avec une métaphore simple : la vie est un théâtre. Nous jouons tous des rôles selon notre public. Ce n’est pas de l’hypocrisie, c’est de la sociologie.
En 2025, cette théorie éclaire nos comportements numériques comme jamais. Instagram, LinkedIn, Tinder : autant de scènes où nous gérons notre image en permanence. Mais sommes-nous encore authentiques ? Découvrons comment Goffman nous aide à décoder nos vies d’acteurs sociaux.
La dramaturgie sociale : nous sommes tous des acteurs
Goffman, le sociologue qui observait les coulisses
Erving Goffman (1922-1982) n’est pas un théoricien de salon. Avant d’écrire, il observe. Dans les années 1950, il s’installe aux îles Shetland, en Écosse, pour étudier une petite communauté rurale. Il note les gestes, les silences, les regards détournés.
Plus tard, il enquête dans un hôpital psychiatrique. Pas comme médecin : comme plongeur dans les cuisines. Cette position lui permet d’observer comment le personnel traite les patients quand personne ne regarde. Ces observations donnent naissance à Asiles (1961), ouvrage choc sur les institutions totales.
Son œuvre majeure, La Présentation de soi (1959), applique au quotidien une métaphore théâtrale. Goffman montre que chaque interaction sociale fonctionne comme une représentation : il y a une scène, un public, un rôle à tenir.
💡 DÉFINITION : Présentation de soi
Ensemble des stratégies conscientes ou inconscientes par lesquelles un individu contrôle l’image qu’il renvoie aux autres dans une interaction sociale. Selon Goffman, nous gérons constamment nos « impressions » pour être perçus positivement.
Exemple : Sourire à un recruteur même si on est stressé.
Scène et coulisses : la dualité de nos vies
Le concept central de Goffman, c’est la distinction scène/coulisses. La scène (front stage) désigne les espaces où nous sommes observés et où nous contrôlons notre comportement. Les coulisses (backstage) sont les espaces privés où nous relâchons la pression.
Un serveur illustre parfaitement cette dualité. En salle, il sourit, reste poli, maîtrise ses gestes : c’est la scène. En cuisine, il râle contre un client difficile, s’affale, lâche les codes : ce sont les coulisses. Aucun des deux comportements n’est plus « vrai » que l’autre. Ils correspondent simplement à des contextes différents.
Cette distinction structure toutes nos vies. Un enseignant prépare son cours chez lui (coulisses), puis le délivre avec assurance devant ses élèves (scène). Un avocat révise son dossier seul (coulisses), puis plaide brillamment au tribunal (scène). Nous alternons en permanence entre ces deux registres.
La socialisation primaire et secondaire nous apprend justement à gérer cette dualité : savoir quand « être sur scène » et quand on peut se relâcher.
La face : ne jamais perdre la face
Goffman introduit aussi le concept de face (face-work). La face, c’est la valeur sociale positive qu’un individu revendique à travers ses interactions. Perdre la face, c’est être ridiculisé, humilié, décrédibilisé publiquement.
Toute interaction sociale est une négociation pour sauver la face — la sienne et celle des autres. C’est pourquoi nous évitons de contredire frontalement quelqu’un en public. Nous rions poliment à une blague ratée. Nous détournons le regard quand quelqu’un trébuche.
Ces petits rituels de politesse ne sont pas superficiels : ils permettent à chacun de maintenir son image sociale. Sans cette protection mutuelle des faces, les interactions deviendraient impossibles. La société repose sur ce jeu subtil de préservation réciproque.
📊 CHIFFRE-CLÉ
78% des utilisateurs Instagram avouent sélectionner longuement leurs photos avant publication (Étude Pew Research, 2024) : la gestion de la face version numérique.
Instagram, Zoom et la vie sociale numérique
Les réseaux sociaux comme scènes permanentes
En 2025, la théorie de Goffman n’a jamais été aussi pertinente. Les réseaux sociaux et notre identité numérique sont des scènes permanentes où nous gérons notre image en continu.
Instagram incarne parfaitement cette dramaturgie. Vos stories, vos posts, vos photos filtrées : tout cela constitue votre scène. Vous choisissez le cadre, la lumière, l’angle. Vous sélectionnez ce qui vous met en valeur. Vous contrôlez le message.
Mais derrière, il y a les coulisses : les dix photos ratées avant la bonne, les moments de doute, la fatigue, les situations peu flatteuses. Personne ne poste une photo en pyjama sale un dimanche matin, sauf pour en faire une blague autorisée. Instagram, c’est du théâtre permanent.
LinkedIn fonctionne pareillement. Votre profil est une façade professionnelle soigneusement construite : formations valorisées, expériences embellies, compétences mises en avant. Les coulisses (les échecs, les doutes, les conflits) restent invisibles.
Zoom : le contrôle total du cadre
La pandémie de Covid a révélé un nouveau terrain de jeu goffmanien : Zoom. En visioconférence, chacun contrôle son cadre avec une précision chirurgicale. Vous choisissez l’arrière-plan (rangé, culturel, flou). Vous cadrez votre visage sous le bon angle. Vous coupez le micro pour tousser.
Certains portent une chemise professionnelle… avec un jogging en bas. La caméra découpe l’espace en scène visible et coulisses cachées. C’est du Goffman pur : maîtrise totale de l’impression donnée.
Les jeunes générations ont même développé des stratégies de gestion de face spécifiques : filtres Snapchat pour corriger son apparence, stories éphémères pour tester une image sans engagement, profils privés pour contrôler son public.
Le coming out comme gestion du stigmate
Goffman a aussi théorisé le stigmate : une marque sociale qui disqualifie un individu. Dans Stigmate (1963), il montre que certaines personnes portent une identité dévalorisée (handicap, orientation sexuelle minoritaire, maladie mentale) et doivent constamment gérer l’information sur elles-mêmes.
Prenons le coming out. Une personne homosexuelle doit décider à qui, quand, comment révéler son orientation. Elle anticipe les réactions, évalue les risques, prépare son discours. C’est une gestion permanente du stigmate.
Certains choisissent de « passer » (se faire passer pour hétérosexuels), d’autres d’afficher fièrement leur identité. Mais dans tous les cas, ils portent ce fardeau de gestion que les personnes non stigmatisées ne connaissent pas. Cette réalité rejoint les questions de normes sociales et déviance : le stigmate n’est pas une propriété de la personne, mais le résultat d’un regard social.
Authenticité ou performance ? Le grand dilemme
Sommes-nous encore « nous-mêmes » ?
La théorie de Goffman soulève une question vertigineuse : existe-t-il un « vrai moi » derrière les rôles ? Ou sommes-nous entièrement constitués par les performances que nous jouons ?
Goffman ne tranche pas. Il suggère que le moi est une construction sociale, une performance. Ce qui ne signifie pas que tout est faux. Jouer sincèrement un rôle reste une forme d’authenticité.
Pensez à un médecin. Il joue le rôle du professionnel rassurant devant son patient. Ce rôle est-il « faux » ? Non : c’est une dimension réelle de son identité professionnelle. Le fait qu’il pleure parfois chez lui après une journée difficile ne rend pas sa performance médicale hypocrite.
Nous sommes multiples. Nous avons plusieurs « moi » selon les contextes. Ce n’est pas de la schizophrénie : c’est de la souplesse sociale. L’important n’est pas d’être « authentique » en permanence, mais de jouer les bons rôles aux bons moments.
La fatigue de la performance
Mais gérer sa présentation de soi épuise. En 2025, la fatigue numérique explose : lassitude de se mettre en scène, pression de la perfection Instagram, anxiété du jugement permanent.
Certains craquent. D’autres désertent les réseaux sociaux. D’autres encore revendiquent une authenticité brute : publier sans filtre, montrer ses failles, refuser la performance. Mais même cette « authenticité » reste une stratégie de présentation de soi. Montrer ses coulisses devient une nouvelle façon de gérer son image.
Goffman nous libère du jugement moral. Il ne dit pas que nous sommes des hypocrites. Il montre que la vie sociale exige de la performance. Comprendre ce mécanisme, c’est se donner la liberté de jouer ses rôles consciemment, sans culpabilité.
Conclusion
Erving Goffman nous offre une lucidité précieuse : nous sommes tous des acteurs sociaux. Instagram n’a pas créé cette dynamique, il l’a simplement rendue visible. La présentation de soi, la gestion de la face, le jeu scène/coulisses traversent toutes nos interactions.
Accepter cette dimension théâtrale de l’existence, ce n’est pas renoncer à l’authenticité. C’est comprendre que nous sommes multiples, que nos rôles font partie de nous, que la performance n’exclut pas la sincérité.
Alors oui : votre vie Instagram est un théâtre. Mais vous en êtes à la fois l’auteur, le metteur en scène et l’acteur principal. Et c’est précisément ce qui la rend humaine.
💬 Partagez cet article si la sociologie des interactions vous passionne !
FAQ
Qu’est-ce que la présentation de soi selon Goffman ?
La présentation de soi désigne l’ensemble des stratégies par lesquelles nous contrôlons l’image que nous renvoyons aux autres. Goffman montre que dans toute interaction, nous « jouons » un rôle adapté à notre public, comme des acteurs sur une scène. Ce n’est pas de l’hypocrisie mais une nécessité sociale.
Quelle est la différence entre scène et coulisses chez Goffman ?
La scène (front stage) désigne les espaces où nous sommes observés et contrôlons notre comportement. Les coulisses (backstage) sont les espaces privés où nous relâchons cette performance. Exemple : un enseignant prépare son cours chez lui (coulisses) puis enseigne devant ses élèves (scène).
Pourquoi Goffman parle-t-il de « face » ?
La face désigne l’image sociale positive qu’un individu revendique. Perdre la face, c’est être humilié publiquement. Goffman montre que toute interaction vise à sauver la face de chacun : on évite de contredire brutalement, on rit poliment aux blagues ratées. Sans cette protection mutuelle, les interactions deviendraient impossibles.
Comment la théorie de Goffman s’applique-t-elle aux réseaux sociaux ?
Instagram, LinkedIn ou TikTok sont des scènes permanentes où nous gérons notre image : choix des photos, contrôle du cadre, sélection des contenus. Les coulisses (photos ratées, doutes, moments peu flatteurs) restent cachées. La dramaturgie sociale de Goffman éclaire parfaitement nos comportements numériques en 2025.
Bibliographie
- Goffman, Erving. 1959. La Présentation de soi (The Presentation of Self in Everyday Life). Paris : Éditions de Minuit.
- Goffman, Erving. 1961. Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux. Paris : Éditions de Minuit.
- Goffman, Erving. 1963. Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Paris : Éditions de Minuit.
- Casilli, Antonio. 2010. Les Liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ? Paris : Seuil.
*Article rédigé par Élisabeth de Marval | 28 octobre 2025 | Les Grands Penseurs