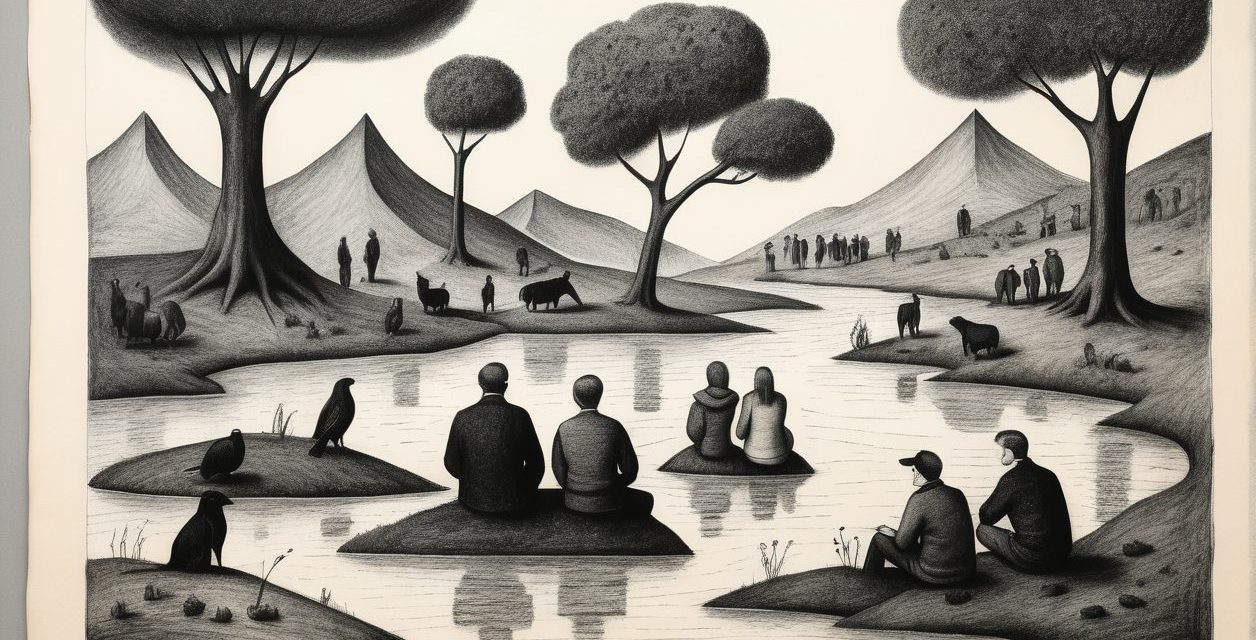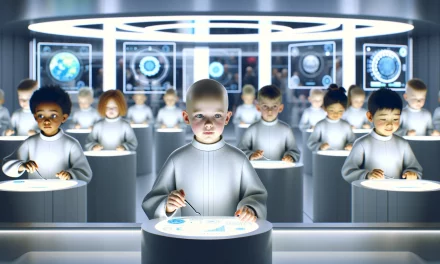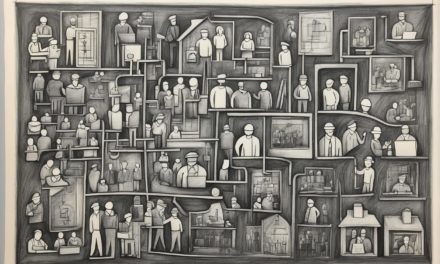- Marc, 21 ans, ouvrier qualifié à Genève, achète son premier appartement après cinq ans d’épargne. Il milite activement pour le suffrage féminin et croit fermement pouvoir « changer le monde ». 2025. Léa, 23 ans, diplômée universitaire à Lausanne, vit encore chez ses parents. Elle estime à 69% qu’elle n’accédera à la propriété que par héritage. Elle consulte un psychologue pour anxiété chronique liée à l’avenir.
Entre ces deux portraits se cache une rupture générationnelle sans précédent en Suisse. En 1970, la majorité des jeunes Suisses voyaient leur avenir avec optimisme. En 2025, seuls 19% des 18-25 ans perçoivent positivement leur futur. Comment une société réputée pour sa stabilité a-t-elle produit cette mutation anthropologique ? Cette analyse sociologique compare deux générations pour comprendre l’effondrement de l’espoir juvénile helvétique et ses implications pour la cohésion sociale du pays.
Les années 1970 : quand la jeunesse suisse croyait au progrès
L’âge d’or économique et l’ascenseur social fonctionnel
La jeunesse suisse des années 1970 bénéficiait d’un contexte économique exceptionnel. Malgré la crise pétrolière de 1973, le taux de chômage restait quasi nul (moins de 1%) et le pouvoir d’achat augmentait de 2,5% annuellement. Un ouvrier pouvait acheter un logement en cinq ans de salaire, contre quinze ans aujourd’hui.
💡 DÉFINITION : Ascenseur social
Mécanisme par lequel un individu peut améliorer sa position sociale par rapport à celle de ses parents, notamment grâce à l’éducation. En Suisse des années 1970, 30% des enfants d’ouvriers accédaient à l’université, témoignant d’une mobilité sociale réelle.
Cette période d’expansion offrait une intégration professionnelle fluide. L’héritage culturel dans l’enseignement supérieurpesait moins lourdement qu’aujourd’hui. La démocratisation universitaire et la gratuité de l’éducation permettaient une ascension sociale tangible, renforçant l’optimisme générationnel.
L’engagement politique comme promesse d’efficacité
Les jeunes Suisses de cette époque incarnaient des valeurs émancipatrices révolutionnaires : rejet de l’autoritarisme, libération des tabous sociaux (suffrage féminin en 1971), expérimentation communautaire. Les mouvements de jeunesse révolutionnaires trouvaient un écho particulier dans les mouvements autonomes zurichois de 1980.
La démocratie directe helvétique offrait un cadre de participation effective. 70% des 18-25 ans votaient régulièrement, contre 35% aujourd’hui. Ce sentiment d’efficacité citoyenne nourrissait la conviction qu’une transformation collective était possible. L’engagement n’était pas perçu comme vain, mais comme un levier réel de changement social.
2025 : la génération de l’anxiété existentielle
La précarité diplômée comme nouvelle norme
La jeunesse contemporaine fait face à une réalité économique drastiquement différente. Le taux de chômage des 18-25 ans atteint 7,6%. Plus significativement, l’accès au logement s’est radicalement dégradé : 69% des jeunes estiment ne pouvoir devenir propriétaires que par héritage.
Cette « précarité diplômée » caractérise une génération qui, malgré un niveau d’études supérieur à celui de leurs aînés, subit une instabilité économique inconnue de leurs parents. En 1970, 30% des enfants d’ouvriers accédaient à l’université ; en 2025, ils ne sont plus que 12%. Le blocage de l’ascenseur social transforme le diplôme en condition nécessaire mais non suffisante.
📊 CHIFFRE-CLÉ
60% des jeunes salariés suisses envisagent de quitter leur entreprise d’ici cinq ans. Cette statistique révèle une perte de confiance massive dans les modèles de carrière traditionnels et une quête de sens au travail que les structures actuelles ne satisfont plus.
La crise de santé mentale comme symptôme sociétal
L’indicateur le plus alarmant de cette transformation réside dans la détérioration de la santé mentale juvénile. 37% des 14-19 ans souffrent de troubles psychologiques, une augmentation de 26% des hospitalisations psychiatriques chez les filles de 10-24 ans entre 2020 et 2021. Cette dégradation précède la pandémie COVID-19, révélant des causes structurelles profondes.
Les jeunes Suisses développent désormais des mécanismes psychologiques inédits : « résignation active » (acceptation lucide des contraintes systémiques), « collapsologie » (anticipation rationnelle d’un effondrement civilisationnel), recherche de « résilience individuelle » face à l’incertitude collective. Là où la génération post-68 concevait la santé mentale comme libération psychologique, les nouveaux analphabètes émotionnels contemporains subissent une thérapeutisation massive sans perspective de transformation collective.
Comprendre la rupture : trois facteurs déterminants
La révolution numérique comme fragmentation identitaire
Les jeunes Suisses de 2025 constituent la première génération entièrement immergée dans l’ère numérique. 97% utilisent WhatsApp, 83% Instagram, 69% TikTok, consacrant en moyenne quatre heures quotidiennes aux plateformes. Cette hyperconnectivité crée des « iPad Kids » déconnectés de la réalité sociale traditionnelle.
L’exposition constante aux fake news (76% des jeunes y sont confrontés) alimente les théories conspirationnistes et facilite la désinformation d’État. Les influences numériques fragmentées remplacent les leaderships structurés de la génération précédente, créant une dispersion des référents collectifs.
Le durcissement institutionnel paradoxal
Alors que la Suisse conserve sa première place OCDE pour la confiance institutionnelle (62% contre 39% de moyenne), les jeunes font face à un durcissement répressif sans précédent. Les activistes climatiques pacifiques sont criminalisés, les frais de manifestation leur sont répercutés, les conditions préventives deviennent draconiennes.
Ce paradoxe révèle un grippage du système d’absorption institutionnelle qui fonctionnait dans les années 1970-80. Seuls 46% des jeunes estiment aujourd’hui que les décisions parlementaires affectent leur quotidien (contre 69% en 2014), témoignant d’une déconnexion entre institutions et réalités juvéniles.
L’effondrement du paradigme progressiste
La mutation la plus profonde réside dans l’épuisement du récit progressiste. La génération 1970 croyait au progrès linéaire et à l’amélioration collective. La génération 2025 anticipe la dégradation inéluctable : 37% considèrent probable une attaque contre l’UE, 30% estiment possible une guerre USA-Russie.
Ce pessimisme géopolitique amplifié par les flux numériques s’accompagne d’une conscience écologique anxiogène. La crise climatique n’apparaît plus comme un défi à relever collectivement, mais comme une fatalité subie individuellement. Les inégalités sociales croissantes qui affectent particulièrement les jeunes générations renforcent ce sentiment d’impuissance systémique.
Réinventer l’espoir collectif : pistes pour la jeunesse suisse
Des signes de résilience créative
Malgré cette résignation apparente, des initiatives innovantes émergent. Le mouvement Solarpunk en Suisse romande réinvente l’utopie écologique par l’action concrète. Les expérimentations de revenus universels à Bâle et l’éducation populaire 2.0 démocratisant l’accès au savoir via les technologies numériques témoignent d’une recherche active de nouveaux imaginaires.
La persistance du modèle familial constitue un socle remarquable de continuité. L’importance de la famille s’est renforcée pour les jeunes Suisses : elle est classée priorité numéro un devant travail et loisirs. Cette résilience relationnelle, avec 367 parcours familiaux distincts identifiés, révèle une inventivité pragmatique face aux contraintes contemporaines.
L’urgence d’une réponse sociétale
La cohésion sociale future de la Suisse dépend de sa capacité à transformer ce pessimisme générationnel en projet collectif renouvelé. Trois leviers majeurs s’imposent : investissement massif en santé mentale juvénile, éducation numérique critique développant la résistance aux algorithmes, création d’espaces d’action collective redonnant le sentiment d’efficacité politique.
L’enjeu dépasse la seule condition juvénile. C’est la stabilité légendaire du pays qui pourrait se fissurer si cette crise d’espoir générationnelle n’est pas prise au sérieux. Éviter l’amnésie collective organisée qui caractérise nos sociétés contemporaines exige de reconnaître pleinement cette rupture anthropologique.
Conclusion : reconstruire la promesse d’avenir
La comparaison entre la jeunesse suisse des années 1970 et celle de 2025 révèle une transformation civilisationnelle majeure. Du sentiment collectif de pouvoir « changer le monde » à la résignation active face à l’impuissance systémique, c’est tout un imaginaire social qui s’est effondré. Cette mutation ne traduit pas un échec individuel, mais l’épuisement d’un modèle de société.
La Suisse se trouve face à un choix civilisationnel : laisser se creuser ce fossé générationnel ou inventer les réponses institutionnelles, économiques et culturelles permettant aux jeunes de retrouver confiance en demain. L’histoire dira si la sagesse helvétique saura transformer cette crise en opportunité de refondation sociale.
Et vous, qu’observez-vous autour de vous : cette rupture générationnelle se vérifie-t-elle dans votre entourage ?
📚 POUR ALLER PLUS LOIN :
→ Héritage culturel et inégalités dans l’enseignement supérieur
→ Les nouveaux analphabètes émotionnels de notre société
→ Inégalités sociales au 21e siècle : pourquoi l’humanité accepte sa servitude
💬 Partagez cet article si la sociologie de la jeunesse vous interpelle !
FAQ
Pourquoi les jeunes Suisses sont-ils plus pessimistes qu’avant ?
Trois facteurs structurels expliquent ce pessimisme : la précarisation économique malgré des diplômes élevés (69% n’envisagent la propriété que par héritage), la crise de santé mentale systémique (37% des 14-19 ans affectés par des troubles psychologiques), et l’effondrement du paradigme progressiste remplacé par une conscience collapsologique. L’ascenseur social bloqué transforme l’éducation en condition nécessaire mais non suffisante.
Qu’est-ce qui différenciait la jeunesse des années 1970 ?
La génération 1970 bénéficiait d’un contexte économique exceptionnel (chômage <1%, accès facilité au logement en 5 ans de salaire), d’une mobilité sociale réelle (30% des enfants d’ouvriers à l’université) et d’un sentiment d’efficacité politique (70% de participation aux votations). Elle croyait au progrès linéaire et à sa capacité de transformation collective, portée par les valeurs post-68.
La santé mentale des jeunes Suisses s’est-elle dégradée ?
Oui, de façon alarmante. 37% des 14-19 ans souffrent de troubles psychologiques en 2025. Les hospitalisations psychiatriques des filles de 10-24 ans ont augmenté de 26% entre 2020-2021. Cette détérioration précède la pandémie COVID-19, révélant des causes structurelles : précarité économique, hyperconnexion numérique fragmentante, absence de perspectives collectives mobilisatrices, et pression performative constante.
Le numérique est-il responsable de cette transformation ?
Le numérique constitue un facteur aggravant majeur mais non exclusif. 97% des jeunes utilisent WhatsApp, 83% Instagram, consacrant 4 heures quotidiennes aux plateformes. Cette hyperconnectivité crée une fragmentation identitaire, expose massivement aux fake news (76%) et aux théories conspirationnistes, tout en générant des pathologies sociales nouvelles (cyberharcèlement, dépendance). Elle remplace les leaderships structurés par des influences algorithmiques dispersées.
Des solutions existent-elles pour inverser cette tendance ?
Oui, trois leviers sociétaux s’imposent : investissement massif en santé mentale juvénile, éducation numérique critique développant la résistance aux algorithmes, et création d’espaces d’action collective redonnant le sentiment d’efficacité politique. Des initiatives émergent déjà (Solarpunk, revenus universels expérimentaux, éducation populaire 2.0) témoignant d’une capacité créative de réinvention. La cohésion sociale future dépend de la reconnaissance institutionnelle de cette crise.
Bibliographie
- Office fédéral de la statistique suisse. 2025. Enquête sur la jeunesse : évolutions 1970-2025. Berne : OFS.
- OCDE. 2025. Rapport sur le bien-être des jeunes dans les pays développés. Paris : Éditions OCDE.
- Bourdieu, Pierre. 1979. La Distinction : Critique sociale du jugement. Paris : Éditions de Minuit.
- Durkheim, Émile. 1897. Le Suicide : Étude de sociologie. Paris : Félix Alcan.