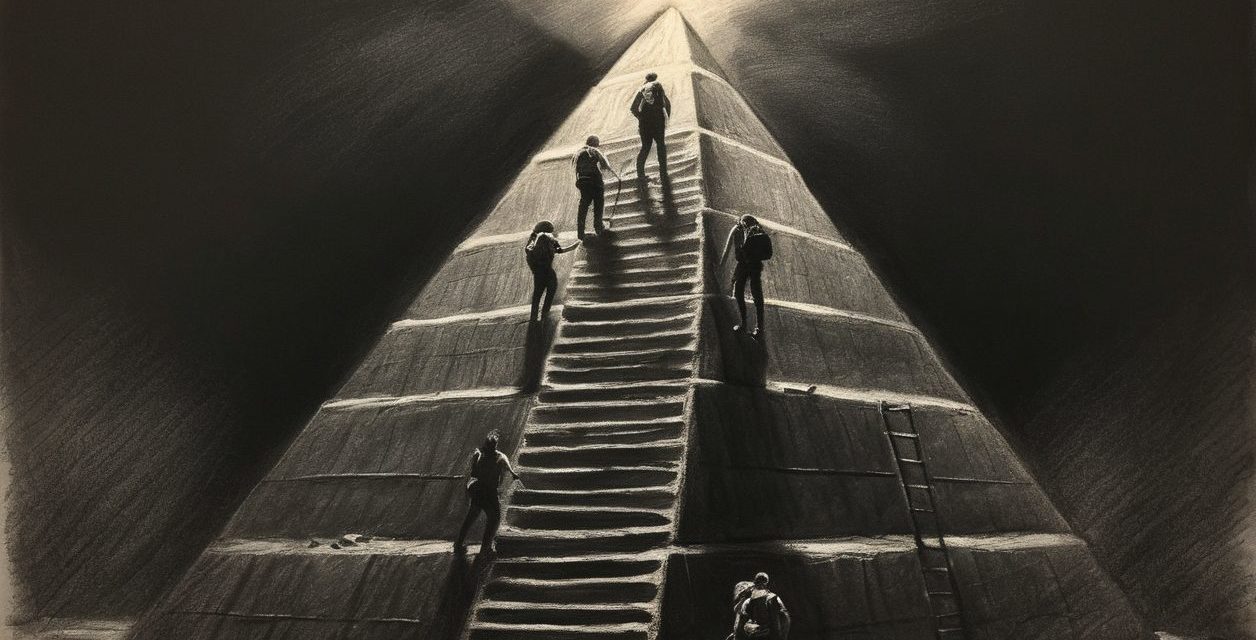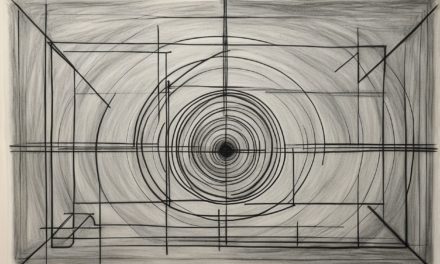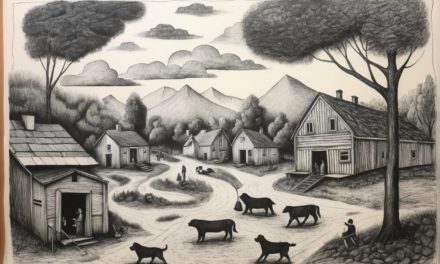13 milliards d’euros : c’est le montant que les métropoles françaises investiront dans leurs projets de villes intelligentes d’ici 2030. Dans le même temps, 12 millions de Français restent en situation d’illectronisme, incapables d’utiliser les services numériques qui redéfinissent l’accès aux droits urbains. Comment expliquer ce paradoxe vertigineux ?
À Paris, dans les couloirs de l’Hôtel de Ville, des écrans géants affichent en temps réel le pouls de la capitale : trafic automobile, consommation énergétique, qualité de l’air. À quelques kilomètres, Fatima, 67 ans, peine encore à comprendre comment renouveler sa carte Navigo dématérialisée. Cette fracture révèle l’un des paradoxes les plus troublants de notre époque : plus nos villes deviennent « intelligentes », plus elles risquent d’exclure ceux qui en ont le plus besoin.
Entre promesses de modernisation et risques d’exclusion, les smart cities françaises naviguent dans un territoire où se joue l’avenir de nos démocraties locales. Décryptage sociologique d’une innovation urbaine à double tranchant.
Table des matières
Le paradoxe français des villes intelligentes
L’émergence des smart cities en France s’inscrit dans une dynamique mondiale portée par l’urgence climatique et les promesses du numérique. Depuis 2010, les métropoles françaises rivalisent d’innovations technologiques.
Lyon se vante de ses 1 500 capteurs environnementaux, Nantes de son écosystème numérique collaboratif, Nice de sa vidéosurveillance « intelligente ». Ces initiatives, soutenues par des investissements publics colossaux, promettent une révolution : services publics plus efficaces, gestion environnementale optimisée, participation citoyenne renforcée.
💡 DÉFINITION : Smart city
Une ville intelligente utilise les technologies numériques (capteurs, algorithmes, données) pour optimiser la gestion urbaine et améliorer la qualité de vie. En France, contrairement aux modèles américains dominés par le privé, l’approche reste pilotée par les collectivités territoriales.
Exemple : Le Grand Paris Express intègre 68 stations automatisées conçues comme des hubs technologiques.
Le Grand Paris incarne cette ambition française. Lancé en 2007, le projet se transforme progressivement en laboratoire européen de la ville intelligente. La Métropole coordonne aujourd’hui 131 communes autour d’une stratégie numérique ambitieuse : plateforme de données métropolitaines, services publics dématérialisés, optimisation énergétique.
Mais cette approche top-down révèle ses limites. Malgré 3 milliards d’euros d’investissements, la coordination entre communes reste problématique et l’appropriation citoyenne demeure inégale.
Lyon illustre une approche différente avec son projet « Lyon Smart Community ». Cette stratégie bottom-up, qui implique davantage les habitants, produit des résultats tangibles : 30% de réduction de consommation énergétique, 40% de baisse des émissions de CO2.
Nantes pousse plus loin avec son écosystème collaboratif autour du « Quartier de la Création ». L’approche nantaise privilégie l’open source et l’implication citoyenne dans la conception des services urbains. Résultat : Nantes figure régulièrement dans le top 5 mondial des villes les plus innovantes.
Cette diversité révèle une réalité fondamentale : il n’existe pas une smart city française, mais des smart cities françaises, chacune adaptant les technologies à son histoire locale. Cette pluralité constitue une richesse mais complique la mutualisation des bonnes pratiques.
Les nouveaux visages de l’exclusion numérique
Paradoxalement, plus les villes françaises deviennent intelligentes, plus elles révèlent l’ampleur des inégalités qui les traversent. L’exclusion numérique urbaine revêt aujourd’hui trois formes distinctes.
Premier niveau : la fracture d’accès et de compétences. Selon l’INSEE, 17% des Français éprouvent des difficultés avec les outils numériques, proportion qui atteint 35% chez les plus de 75 ans et 28% dans les quartiers prioritaires.
À Marseille, cette réalité se traduit concrètement : dans les quartiers Nord, 40% des foyers ne disposent pas d’un accès internet fixe performant, contre 8% dans les arrondissements Sud. Cette fracture d’équipement se double d’une fracture de compétences : 60% des habitants des quartiers prioritaires marseillais déclarent ne pas maîtriser les démarches administratives en ligne.
📊 CHIFFRE-CLÉ
23% des Marseillais ont renoncé à une démarche administrative à cause de sa dématérialisation exclusive, selon le Défenseur des droits (2023).
Deuxième niveau : l’exclusion d’usage. À Nice, l’application « Nice Smart City » propose plus de 50 services urbains intégrés. Mais l’analyse sociologique de ses utilisateurs révèle une forte homogénéité : 78% sont des cadres ou professions intermédiaires, 82% ont un niveau d’études supérieur, 71% résident dans les quartiers centraux.
Les habitants des quartiers populaires, pourtant premiers concernés par l’amélioration des services publics, demeurent largement absents de cette « intelligence » urbaine. Cette exclusion reflète ce que la sociologue Zeynep Tufekci nomme « l’inégalité algorithmique » : les systèmes optimisent leurs performances pour leurs utilisateurs les plus actifs, créant un biais en faveur des populations déjà privilégiées.
À Lyon, l’algorithme de répartition des Vélo’v favorise mécaniquement les stations des quartiers d’affaires au détriment de la périphérie, reproduisant les inégalités territoriales existantes.
Troisième niveau : la surveillance différentielle. L’exemple niçois de la vidéosurveillance « intelligente » est révélateur. Officiellement destinée à améliorer la sécurité urbaine, elle déploie des algorithmes de reconnaissance faciale principalement dans les quartiers populaires.
Cette géographie sélective transforme certains espaces urbains en zones de contrôle technologique permanent, questionnant le principe d’égalité républicaine. Lorsqu’Henri Lefebvre théorisait en 1968 le concept de droit à la ville développé par Henri Lefebvre comme droit à la centralité urbaine, il anticipait sans le savoir ces enjeux contemporains de la ville numérique.
💡 DÉFINITION : Illectronisme
L’illectronisme désigne la difficulté voire l’incapacité à utiliser les outils numériques et Internet pour accomplir des démarches essentielles. Ce terme, contraction d’« illettrisme » et d’« électronique », touche particulièrement les personnes âgées et les populations précaires.
Vers une citoyenneté numérique inclusive
Face à ces constats, les métropoles françaises développent progressivement des politiques d’inclusion numérique. Mais peuvent-elles inverser la tendance ?
Paris investit 50 millions d’euros dans son plan « Numérique pour tous » (2020-2026) : 100 espaces numériques de quartier, formation de 10 000 médiateurs numériques, équipement de 30 000 foyers précaires. Lyon expérimente des « conseillers numériques France Services » itinérants qui accompagnent les habitants dans leurs démarches digitales.
Nantes mise sur l’open source et la réappropriation citoyenne des données via son « Conseil Nantais de l’Innovation Sociale ». La métropole a développé « Decidim », une plateforme participative qui intègre des mécanismes de compensation : quota territorial, tirage au sort de citoyens-jurés, débats hybrides.
Ces initiatives, bien qu’importantes, nécessitent un changement de paradigme plus profond. L’inclusion numérique ne se décrète pas : elle exige une refonte de la conception même des services urbains, plaçant l’accessibilité universelle au cœur du design plutôt qu’en correctif a posteriori.
L’avènement des smart cities pose une question philosophique fondamentale : comment préserver la citoyenneté urbaine à l’ère des algorithmes ? Cette interrogation transforme le « droit à la ville » en « droit à la ville numérique » : droit d’accéder aux services algorithmiques, droit de comprendre leur fonctionnement, droit de participer à leur conception.
L’expérience parisienne du budget participatif numérique illustre ces tensions. Lancé en 2014, ce dispositif permet aux citoyens de proposer et voter en ligne pour des projets d’aménagement (500 millions d’euros investis en dix ans). Mais l’analyse sociologique montre une surreprésentation des cadres supérieurs (45% contre 20% dans la population) et une sous-représentation des ouvriers (12% contre 35%).
La participation citoyenne et démocratie locale numérique, loin de démocratiser les décisions, peut reproduire voire amplifier les inégalités politiques existantes. Nice tente de corriger ces dérives avec sa « Charte de l’IA municipale » (2023), qui garantit aux citoyens un droit d’explication sur les décisions automatisées et un droit de recours contre les algorithmes.
Cette évolution vers une « citoyenneté algorithmique » nécessite aussi de nouvelles compétences. Comment exercer ses droits démocratiques quand les enjeux urbains deviennent techniques ? Les métropoles commencent à intégrer cette dimension : cours d’« alphabétisation algorithmique » dans les maisons de quartier parisiennes, ateliers de décryptage des données urbaines à Lyon.
Conclusion
La smart city française se trouve à un carrefour décisif. Entre promesses d’optimisation et risques d’exclusion, nos métropoles doivent inventer un modèle original d’intelligence urbaine qui place l’inclusion au cœur de sa conception.
Cette transformation exige un changement de paradigme : passer d’une logique de « ville pour les citoyens » à une logique de « ville par les citoyens ». L’intelligence urbaine de demain se mesurera moins à sa sophistication technologique qu’à sa capacité d’inclusion sociale.
Une ville vraiment intelligente ne sera pas celle qui optimise le mieux ses flux de données, mais celle qui garantit à tous ses habitants un égal accès à l’intelligence collective. Car au final, l’intelligence d’une ville ne réside ni dans ses algorithmes ni dans ses capteurs, mais dans la qualité du lien social qu’elle produit.
Et vous, avez-vous déjà expérimenté l’exclusion numérique dans votre ville ? Comment imaginez-vous la smart city inclusive de demain ?
📚 POUR ALLER PLUS LOIN :
→ Henri Lefebvre et le droit à la ville : comprendre la sociologie urbaine
→ Fracture numérique en France : cartographie des inégalités
→ Budget participatif : quand la démocratie locale devient numérique
💬 Partagez cet article si la sociologie urbaine vous passionne !
FAQ
Qu’est-ce qu’une smart city exactement ?
Une smart city (ville intelligente) utilise les technologies numériques – capteurs, algorithmes, données – pour optimiser la gestion urbaine : trafic, énergie, sécurité, services publics. En France, contrairement aux modèles américains ou asiatiques, l’approche reste principalement pilotée par les collectivités territoriales plutôt que par des entreprises privées.
Pourquoi parle-t-on d’exclusion numérique dans les villes intelligentes ?
L’exclusion numérique dans les smart cities prend trois formes : la fracture d’accès (12 millions de Français en situation d’illectronisme), l’exclusion d’usage (services conçus pour les populations déjà privilégiées) et la surveillance différentielle (technologies de contrôle déployées prioritairement dans les quartiers populaires). Plus une ville se numérise, plus elle risque d’exclure les populations fragiles.
Quelles villes françaises sont les plus avancées en matière de smart city ?
Paris, Lyon et Nantes figurent parmi les pionnières. Paris investit massivement dans le Grand Paris Express et sa plateforme de données métropolitaines. Lyon excelle dans l’innovation environnementale avec 30% de réduction énergétique. Nantes se distingue par son approche participative et open source, la plaçant régulièrement dans le top 5 mondial des villes les plus innovantes.
Comment garantir l’inclusion numérique dans les villes intelligentes ?
L’inclusion nécessite plusieurs leviers : formation de médiateurs numériques, création d’espaces publics d’accompagnement, conception universelle des services (accessibles sans compétences techniques avancées), maintien d’alternatives non-numériques, et garantie de droits nouveaux comme le droit à l’explication des décisions algorithmiques. L’enjeu est de penser l’accessibilité dès la conception, pas en correctif.
Quel est le lien entre smart city et démocratie participative ?
Les smart cities françaises expérimentent de nouvelles formes de participation citoyenne : budgets participatifs numériques (500 millions d’euros à Paris), plateformes de concertation en ligne, applications de signalement citoyen. Mais ces outils reproduisent souvent les inégalités existantes, favorisant les populations déjà engagées. L’enjeu est de concevoir une « citoyenneté algorithmique » véritablement inclusive.
Bibliographie
Défenseur des droits. 2023. Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics. Paris : Rapport annuel.mes ni dans ses capteurs, mais dans la qualité du lien social qu’elle produit et dans la capacité qu’elle offre à chacun de ses habitants d’être pleinement citoyen de l’urbain.
Lefebvre, Henri. 1968. Le droit à la ville. Paris : Anthropos.
Tufekci, Zeynep. 2014. « Engineering the public: Big data, surveillance and computational politics ». First Monday, 19(7).
Cardon, Dominique. 2019. Culture numérique. Paris : Presses de Sciences Po.
Douay, Nicolas. 2018. La planification urbaine française à l’heure du numérique. Paris : L’Œil d’Or.