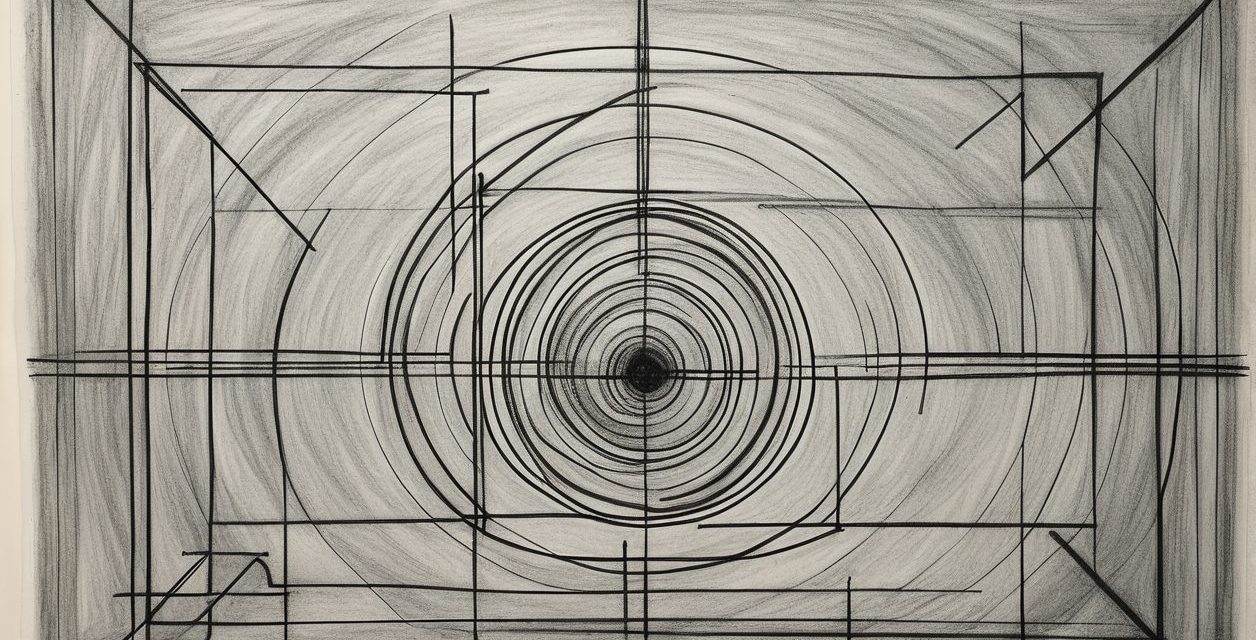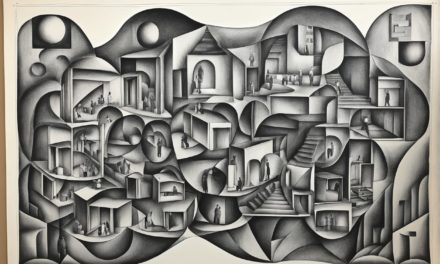Lorsqu’un peuple opprimé accède au pouvoir, reproduit-il la violence qu’il a subie ? Cette question traverse l’histoire humaine avec une régularité troublante. De la Shoah aux génocides du XXe siècle, un constat s’impose : la mémoire de la souffrance n’immunise pas contre la barbarie. Elle peut même, dans certaines conditions, la justifier.
Cette réalité inconfortable révèle des mécanismes psychologiques et sociologiques universels. Comprendre comment les victimes peuvent devenir bourreaux n’excuse rien, mais éclaire les dynamiques qui perpétuent les cycles de violence à travers les générations.
Table des matières
La banalité du mal : quand l’ordinaire tue
Hannah Arendt l’a démontré lors du procès Eichmann en 1961 : le mal n’a pas besoin de sadisme pour prospérer. L’architecte de la Solution finale n’était ni un monstre ni un idéologue fanatique. C’était un bureaucrate méticuleux qui obéissait aux ordres sans se poser de questions.
Cette banalité du mal révèle une vérité dérangeante : dans certaines circonstances, des individus ordinaires commettent l’inacceptable par simple conformité à l’autorité. L’expérience de Milgram (1963) le confirme : 65% des participants acceptent d’infliger des souffrances potentiellement mortelles si une figure d’autorité légitime le leur ordonne.
Le mécanisme repose sur la dilution de responsabilité. Dans une chaîne bureaucratique, chacun se perçoit comme un simple rouage : « Je ne fais qu’obéir », « Je ne suis qu’un parmi tant d’autres », « Ce n’est pas moi qui décide ». Cette fragmentation morale permet d’assassiner en masse tout en se regardant dans le miroir chaque matin.
💡 DÉFINITION : Banalité du mal
Concept d’Hannah Arendt désignant la capacité d’individus ordinaires à commettre des atrocités par obéissance aveugle à l’autorité, sans sadisme ni idéologie personnelle, mais par simple absence de réflexion critique.
Exemple : Eichmann organisant la logistique de la déportation « comme on organise un transport de marchandises », sans considérer l’humanité des victimes.
La fabrique du consentement : trois étapes vers l’horreur
Comment une société bascule-t-elle collectivement dans la violence ? Jamais brutalement. Le processus suit une progression méthodique décrite par Chomsky et Herman dans Manufacturing Consent (1988).
Première étape : changer les mots. L’ennemi devient « terroriste », « animal », « menace existentielle ». La victime disparaît du langage pour devenir statistique, dommage collatéral, neutralisation. Cette novlangue déshumanise progressivement.
Deuxième étape : invisibiliser la souffrance. On cesse de montrer les corps. On ne dit plus les noms. On ne raconte plus les histoires. La douleur de l’autre devient abstraite, négociable. Sans visage, la victime cesse d’interpeller notre conscience.
Troisième étape : normaliser l’exception. Les mesures d’urgence deviennent permanentes. L’inacceptable d’hier devient la norme d’aujourd’hui. Giorgio Agamben parle d' »état d’exception permanent » : les droits fondamentaux sont suspendus indéfiniment au nom de la sécurité.
Chiffre révélateur : Le sociologue Gregory Stanton a modélisé les dix étapes du génocide, de la classification (« eux » vs « nous ») jusqu’au déni final. Ce schéma s’est répété au Rwanda (1994), en Bosnie (1990), au Darfour (2000). Chaque fois, la communauté internationale a regardé ailleurs jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
Le trauma choisi : quand la mémoire devient prison
Vamik Volkan, psychanalyste spécialiste des conflits, a identifié le concept de « trauma choisi » : un groupe s’identifie tellement à sa blessure historique qu’il organise toute son existence autour d’elle. La souffrance devient identité. Et cette identité figée dans la douleur cherche inconsciemment à reproduire le schéma traumatique, mais inversé cette fois : victime hier, bourreau aujourd’hui.
Primo Levi, survivant d’Auschwitz, avait vu ce danger. Dans Les Naufragés et les Rescapés (1986), son dernier livre testament, il met en garde : « La mémoire n’immunise pas contre la barbarie. Elle peut même, dans certaines conditions, devenir prétexte à de nouvelles barbaries. »
Levi parlait de la « zone grise » – cette région trouble où victimes et bourreaux s’entremêlent. Dans les camps, certains prisonniers devaient guider d’autres déportés vers les chambres à gaz pour survivre quelques semaines de plus. Complices ? Victimes ? Les deux ?
Judith Butler, dans Parting Ways (2012), insiste : la véritable leçon de la catastrophe devrait être une éthique de vulnérabilité partagée. Reconnaître que toute vie est précaire, que toute mort compte. Pas une appropriation exclusive de la souffrance qui nierait celle des autres.
Les quatre mécanismes du désengagement moral
Comment des individus ordinaires peuvent-ils cautionner ou commettre des atrocités ? Le psychologue Albert Bandura a identifié quatre mécanismes de désengagement moral :
Le déplacement de responsabilité : « Je n’ai pas le choix », « C’est la faute de l’ennemi qui m’y contraint »
La diffusion de responsabilité : « Je ne suis qu’un parmi tant d’autres », « Ma part individuelle est négligeable »
La distorsion des conséquences : Minimiser, euphémiser, nier l’ampleur de la souffrance infligée
La déshumanisation de la victime : L’ennemi n’est plus un être humain avec des émotions, une famille, des rêves
Ces mécanismes ont fonctionné dans toutes les catastrophes du XXe siècle. Ils fonctionnent aujourd’hui. Ils constituent l’infrastructure cognitive qui permet aux génocides de se déployer avec la participation de populations entières.
Que faire ? L’exigence éthique au quotidien
Face à ces mécanismes, que reste-t-il ? Des choix quotidiens, modestes, obstinés.
S’informer auprès de sources critiques. Refuser la pensée unique. Chercher les voix dissidentes. Écouter les témoins directs plutôt que les commentateurs officiels.
Nommer précisément les choses. Ne pas accepter l’euphémisme. Appeler la violence violence. L’injustice injustice. L’oppression oppression.
Maintenir l’empathie. Refuser la déshumanisation de quiconque. Chaque vie compte. Chaque mort est une tragédie.
Agir à son échelle. Manifester. Soutenir les organisations qui résistent. Partager l’information. Ces actions semblent dérisoires, mais c’est leur accumulation qui finit par changer les rapports de force.
Emmanuel Levinas fondait son éthique sur la responsabilité infinie envers autrui. Le visage de l’autre, dans sa vulnérabilité nue, nous interpelle et nous oblige. Cette responsabilité est antérieure à tout choix. Elle est la structure même de notre humanité.
Conclusion
La violence héritée n’est pas une fatalité. C’est un choix collectif que nous pouvons défaire. La mémoire peut être prison ou libération. Prison quand elle fige l’identité dans le ressentiment. Libération quand elle nous rappelle notre commune vulnérabilité.
Comme l’enseignait Bertolt Brecht : « Dans les temps sombres, chantera-t-on aussi ? Oui, on chantera. Sur les temps sombres. » Témoigner. Résister. Maintenir vivante la possibilité d’un monde différent. C’est tout ce que nous avons. Et c’est immense.
La question n’est plus : « Comment les autres ont-ils pu en arriver là ? » La vraie question est : « Dans quelles circonstances pourrions-nous, nous aussi, basculer ? »
📚 POUR ALLER PLUS LOIN :
→ La théorie de la violence symbolique de Bourdieu
→ Les mécanismes de la reproduction sociale
→ Comprendre les bases de la sociologie
💬 Partagez cet article si la réflexion critique vous importe !
FAQ
Qu’est-ce que la banalité du mal selon Hannah Arendt ?
La banalité du mal désigne la capacité d’individus ordinaires à commettre des atrocités non par sadisme, mais par obéissance aveugle à l’autorité et absence de réflexion critique. Arendt l’a théorisée en observant Eichmann : un bureaucrate méticuleux organisant la Shoah sans idéologie personnelle, simplement en « faisant son travail ».
Comment la mémoire traumatique peut-elle justifier de nouvelles violences ?
Lorsqu’un groupe s’identifie exclusivement à sa souffrance historique (le « trauma choisi »), cette mémoire devient identitaire. Le groupe peut alors instrumentaliser sa victimisation passée pour justifier la violence présente, transformant « nous avons souffert » en « nous avons le droit ». Primo Levi avertissait que cette logique pervertit la mémoire en l’utilisant comme permis d’oppression.
Quels sont les mécanismes qui permettent le génocide ?
Les génocides suivent des étapes prévisibles : classification (« eux » vs « nous »), symbolisation (marqueurs visuels), discrimination légale, déshumanisation (comparaisons animales), organisation de la violence, polarisation (élimination des modérés), préparation, persécution systématique, extermination, et déni. Le psychologue Bandura ajoute quatre mécanismes cognitifs : déplacement de responsabilité, diffusion de responsabilité, distorsion des conséquences, et déshumanisation de la victime.
Comment résister individuellement à ces mécanismes ?
La résistance commence par le refus de la normalisation : nommer précisément les violences, maintenir l’empathie envers toutes les victimes, s’informer auprès de sources critiques, et agir à son échelle (manifestations, soutien aux organisations, partage d’information). Comme l’écrivait Camus : « Je me révolte, donc nous sommes. » La pensée critique et le témoignage perturbent la machine du consentement.
Bibliographie
- Arendt, Hannah. 1963. Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal. Gallimard.
- Levi, Primo. 1986. Les Naufragés et les Rescapés. Gallimard.
- Butler, Judith. 2012. Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism. Columbia University Press.
- Herman, Edward & Chomsky, Noam. 1988. Manufacturing Consent. Pantheon Books.
- Milgram, Stanley. 1974. Soumission à l’autorité. Calmann-Lévy.
Article rédigé par Élisabeth de Marval | Novembre 2025 | Philosophie & Sociologie