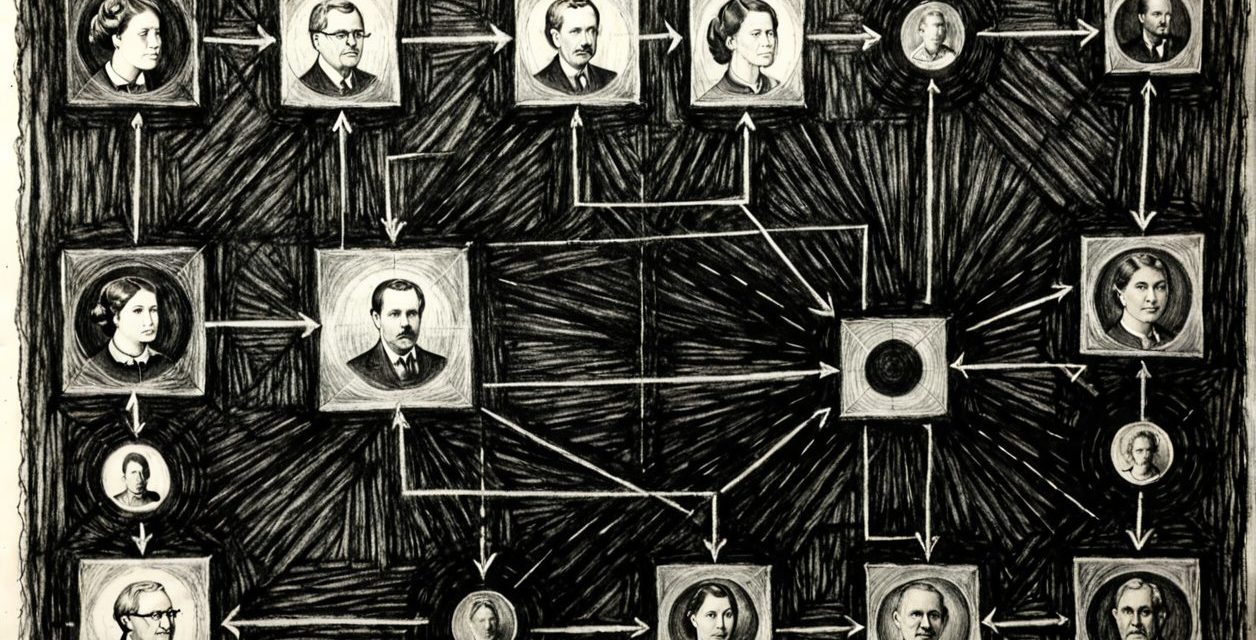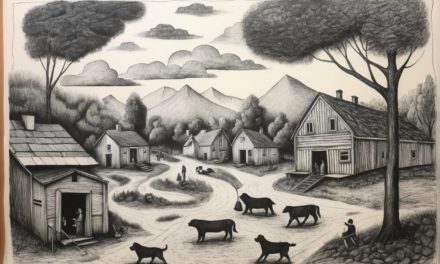Uber vaut 40 milliards de dollars avec seulement 1 500 employés. Orange, pour une valorisation équivalente, en compte 100 000. Cette disparition saisissante entre création de valeur et emploi résume toute l’ambiguïté de l’économie du partage.
Selon un rapport du Sénat français, les prévisions pour 2025 annoncent 572 milliards d’euros de revenus pour l’économie collaborative en Europe. Derrière ces chiffres vertigineux se cache une question essentielle : ces plateformes incarnent-elles l’avènement d’une société plus solidaire et écologique, ou représentent-elles simplement la dernière mutation d’un capitalisme de plateforme particulièrement efficace ?
Cette interrogation mobilise aujourd’hui sociologues, économistes et citoyens. Car au-delà des discours marketing, ce sont nos rapports sociaux et notre conception du partage qui se transforment.
Table des matières
Le mythe du partage : quand la collaboration devient transaction
L’appropriation d’un vocabulaire émancipateur
L’économie collaborative devait révolutionner nos rapports sociaux. Les pionniers imaginaient une société où l’usage primerait sur la possession, où la convivialité l’emporterait sur la compétition, où nous mutualiserions nos ressources. Cette promesse visait explicitement à atténuer l’hyperconsommation tout en créant du lien communautaire.
Dans les faits, nous assistons aujourd’hui à ce que certains chercheurs nomment le « sharewashing » : l’appropriation du concept de partage sans qu’il y ait un quelconque échange authentique dans l’activité économique. L’exemple d’Airbnb illustre parfaitement ce glissement. 80 % des logements sur Airbnb sont loués par des propriétaires possédant plusieurs biens. Où se situe le partage dans cette équation ?
💡 DÉFINITION : Sharewashing
Stratégie marketing consistant à utiliser le vocabulaire du partage et de la collaboration pour des activités purement commerciales. Par analogie avec le greenwashing (écoblanchiment), ce terme dénonce l’instrumentalisation de l’idéal collaboratif à des fins lucratives.
Du Couchsurfing à Uber : chronique d’une récupération
Le vocabulaire pose problème. Continuer d’employer l’expression « économie du partage » revient à faire appel à l’émotion initiale suscitée par des initiatives authentiques comme Couchsurfing.org, où aucun échange monétaire n’intervenait. L’appropriation de termes comme « partage », « collaboration » ou « communauté » par des multinationales valorisées en milliards révèle une stratégie redoutablement efficace.
Cette récupération sémantique n’est pas anodine. Elle permet aux plateformes de bénéficier de la légitimité associée aux pratiques solidaires tout en développant des modèles économiques radicalement différents. Le sociologue Juliet Schor parle à ce propos d’un « capitalisme de réputation » qui transforme la confiance communautaire en ressource extractible.
Les mécanismes du capitalisme de plateforme
L’exploitation masquée derrière l’autonomie
« Devenir son propre patron » : voilà le slogan séduisant des plateformes. Mais la réalité s’avère bien plus sombre. Aux États-Unis, les profits médians des chauffeurs Uber s’élèvent à 3,37 dollars de l’heure. Plus inquiétant encore : 74 % des chauffeurs gagnent moins que le salaire minimum en vigueur dans leur État, et 30 % perdent de l’argentune fois soustraites les dépenses d’entretien du véhicule.
Ces chiffres illustrent un phénomène global : l’externalisation systématique des coûts et des risques vers les travailleurs. Le chauffeur Uber finance son véhicule, son assurance, son carburant et sa protection sociale. Le loueur Airbnb nettoie, entretient et sécurise son logement. Pendant ce temps, les plateformes captent 15 à 20 % de chaque transaction sans assumer aucun des risques traditionnels de l’entrepreneuriat.
📊 CHIFFRE-CLÉ
Airbnb possède la capacité impressionnante de générer du profit en reportant quasiment tous les « risques économiques » sur les personnes qu’elle se contente — officiellement — de « mettre en relation ».
Cette configuration rappelle ce que le sociologue Pierre-Michel Menger analyse comme la « gestion individualisée de l’incertitude » : les travailleurs supportent seuls la variabilité de la demande, l’absence de revenus stables et l’insécurité sociale.
L’évasion fiscale institutionnalisée
Comme leurs prédécesseurs du numérique (Google, Apple, Facebook, Amazon), les nouveaux acteurs du commerce en ligne suivent la route du contournement fiscal. Cette stratégie leur permet de proposer des prix artificiellement bas tout en maximisant leurs profits.
L’ironie est saisissante : ces entreprises de « partage » refusent de partager leurs bénéfices avec les collectivités qui financent les infrastructures dont elles dépendent. Routes pour Uber, services publics pour Airbnb… L’économie dite « du partage » n’aime ni la répartition des revenus, ni contribuer par l’impôt aux infrastructures des pays au sein desquels elle prospère.
Cette asymétrie fiscale crée une concurrence déloyale avec les acteurs traditionnels (taxis, hôtels) qui, eux, supportent la fiscalité locale. Elle pose également la question de la soutenabilité d’un modèle économique qui socialise les coûts d’infrastructure tout en privatisant les profits.
Les promesses légitimes d’une économie collaborative
L’environnement : un bénéfice réel mais conditionnel
Reconnaissons les mérites écologiques indéniables de certaines pratiques collaboratives. Le covoiturage via BlaBlaCar réduit le nombre de véhicules sur les routes et les émissions de CO2 liées au transport. Le principe est séduisant : l’utilisation efficace des ressources aide à réduire le gaspillage et l’empreinte écologique. Plutôt que de posséder individuellement des objets utilisés sporadiquement, nous les mutualisons.
Attention toutefois aux effets pervers. Certaines études montrent qu’Uber augmente parfois le trafic urbain en détournant des usagers des transports en commun. L’impact environnemental réel dépend largement des modalités d’usage et de la régulation publique. La mutualisation ne garantit pas automatiquement la sobriété écologique.
Le lien social : entre mythe et réalité
Sur le plan social, l’économie collaborative peut effectivement promouvoir la solidarité en créant des réseaux de confiance. Elle favorise potentiellement les interactions sociales positives et le renforcement des communautés locales.
Des plateformes comme les AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) ou les systèmes d’échange local témoignent d’une solidarité authentique. Certaines initiatives jouent même un rôle crucial dans l’inclusion sociale, comme HandiEchange, qui permet aux personnes en situation de handicap de proposer leurs services.
Mais attention à ne pas généraliser. La « communauté » Uber se limite souvent à un système de notation mutuelle, loin de l’idéal collaboratif originel. Le sociologue Antonio Casilli parle à ce propos de « digital labor » : un travail relationnel non rémunéré qui produit de la valeur pour les plateformes.
L’accessibilité économique : un progrès ambivalent
Pour les consommateurs, l’économie collaborative offre indéniablement des alternatives moins chères. 76 % des utilisateurs avancent comme avantage principal la possibilité de réaliser des économies. Dans un contexte de stagnation du pouvoir d’achat, cette dimension n’est pas anecdotique.
Le covoiturage, la location entre particuliers, l’achat d’occasion… ces pratiques permettent à de nombreux foyers d’accéder à des services autrefois hors de portée. C’est un progrès social réel, même s’il masque parfois l’appauvrissement général de certaines catégories. Cette accessibilité pose néanmoins question : résulte-t-elle d’une optimisation vertueuse ou de la précarisation des travailleurs ?
Construire une économie vraiment solidaire
Les critères d’une authentique collaboration
Comment distinguer une vraie initiative collaborative d’une plateforme capitaliste ? L’économie collaborative sociale et solidaire se définit comme une économie horizontale de relation directe tournée vers la mutualisation et le partage des connaissances, des services et des biens, où les échanges reposent sur l’équité, la transparence et la convivialité.
Les projets authentiquement collaboratifs partagent plusieurs caractéristiques :
- Gouvernance participative : les utilisateurs participent aux décisions
- Lucrativité encadrée : les bénéfices sont réinvestis dans le projet social
- Transparence : les algorithmes et pratiques sont ouverts à l’examen
- Ancrage territorial : priorité au développement local
L’urgence d’une régulation intelligente
Face à cette ambiguïté, quelle réponse apporter ? Le Conseil économique et social européen (CESE) invite instamment la Commission à prendre des mesures politiques « pour qu’au niveau de l’UE et dans chaque État membre » l’économie du partage « gagne en crédibilité et suscite davantage la confiance ».
À terme, même si cela réduit leur rentabilité, ces plateformes devront accepter une régulation raisonnable ou disparaître. Mais cette régulation doit être subtile : l’enjeu n’est pas d’étouffer l’innovation, mais de créer des conditions de concurrence équitables entre acteurs traditionnels et plateformes numériques.
Cela implique notamment : la clarification du statut des travailleurs, l’harmonisation fiscale, la protection des données personnelles, et la promotion de modèles coopératifs alternatifs aux plateformes capitalistiques.
Conclusion : choisir la direction
L’économie du partage n’est ni le paradis collaboratif rêvé ni l’enfer capitaliste dénoncé. Elle révèle plutôt les contradictions de notre époque : notre aspiration à plus de solidarité face à la récupération marchande de nos désirs.
S’il existe effectivement des initiatives ouvrant à une redéfinition de nos rapports économiques, allant dans le sens d’une collaboration authentique et d’une meilleure optimisation des ressources, coexistent également Uber, Airbnb et autres plateformes extractives.
Notre défi en tant que citoyens ? Développer notre esprit critique pour soutenir les vrais projets collaboratifs tout en exigeant plus de transparence des géants du secteur. Car au-delà des discours marketing, ce sont nos rapports sociaux qui se transforment. Voulons-nous un monde où tout se monnaye via des plateformes privées, ou préférons-nous construire de véritables communs numériques et sociaux ?
📚 POUR ALLER PLUS LOIN :
→ Comprendre le capitalisme selon Marx : analyse des rapports de production → L’agriculture biologique : entre idéal écologique et réalités sociales → Les classes sociales aujourd’hui : Bourdieu reste-t-il pertinent ?
💬 Partagez cet article si la sociologie des transformations économiques vous passionne !
FAQ
Qu’est-ce que l’économie du partage ?
L’économie du partage désigne initialement des pratiques de mutualisation de ressources (logements, véhicules, objets) via des plateformes numériques. Le concept a évolué pour inclure aussi bien des initiatives solidaires authentiques (AMAP, Couchsurfing) que des entreprises capitalistes utilisant le vocabulaire collaboratif (Uber, Airbnb). La distinction repose sur la gouvernance, la répartition des bénéfices et la nature des échanges.
Pourquoi parle-t-on de « sharewashing » ?
Le sharewashing désigne l’appropriation marketing du vocabulaire du partage par des entreprises poursuivant uniquement des objectifs lucratifs. Par analogie avec le greenwashing (écoblanchiment), ce terme critique l’instrumentalisation de l’idéal collaboratif. Airbnb en est l’exemple type : 80 % de ses logements sont loués par des propriétaires multi-possédants, éloignant la pratique du partage authentique pour en faire une activité commerciale.
L’économie collaborative est-elle vraiment écologique ?
L’impact environnemental dépend fortement des modalités d’usage. Le covoiturage (BlaBlaCar) réduit effectivement les émissions en optimisant l’occupation des véhicules. Mais certaines plateformes comme Uber peuvent augmenter le trafic urbain en détournant des usagers des transports en commun. La mutualisation ne garantit pas automatiquement la sobriété écologique : tout dépend de la régulation et des comportements induits.
Comment distinguer une vraie plateforme collaborative d’une entreprise capitaliste ?
Plusieurs critères permettent de différencier : la gouvernance participative (les utilisateurs participent-ils aux décisions ?), la répartition des bénéfices (réinvestis dans le projet social ou versés aux actionnaires ?), la transparence(algorithmes et pratiques ouverts ?), et l’ancrage territorial (développement local privilégié ?). Les vraies plateformes collaboratives s’inscrivent généralement dans l’économie sociale et solidaire avec une lucrativité encadrée.
Bibliographie
- Schor, Juliet. 2014. Debating the Sharing Economy. Great Transition Initiative.
- Casilli, Antonio A. 2019. En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic. Paris : Seuil.
- Dardot, Pierre et Christian Laval. 2014. Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle. Paris : La Découverte.
- Sénat français. 2017. Rapport d’information sur l’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace.